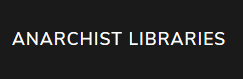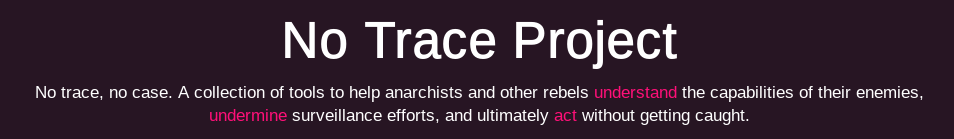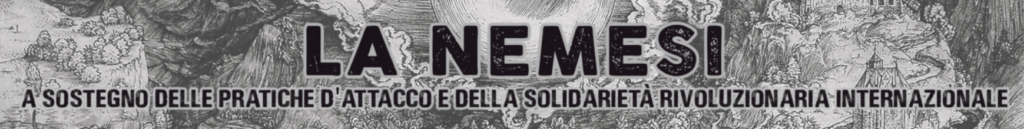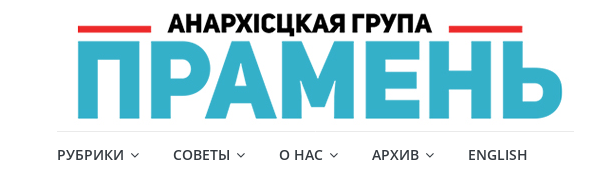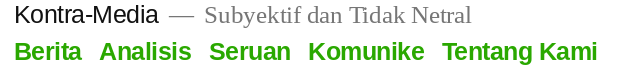Il Rovescio / jeudi 29 octobre 2020
 Voilà ce qu’on appelle « saisir le problème ». C’est ce qui vient à l’esprit quand on regarde les images des manifestations (et des émeutes) de la soirée du 23 octobre, à Naples, quand des milliers de personnes ont afflué dans les rues et les places du chef-lieu de la Campanie et ont violé la première nuit de couvre-feu. Ce qui frappe (en plus de la rage et de la détermination : dans ce pays, il n’arrive pas souvent de voir la police anti-émeute qui s’enfuit) c’est la lucidité des demandes. Pas de complotismes, ni de paranoïas à propos d’une « dictature sanitaire », de l’inexistence de l’épidémie ou de sa création par une quelque lobby plus ou moins fantomatique, mais un simple raisonnement qui saisit la contradiction matérielle de la situation : « tu nous fais fermer, tu nous payes », comme disait l’une des banderoles (d’autres exprimaient, en d’autres termes, le même fond).
Voilà ce qu’on appelle « saisir le problème ». C’est ce qui vient à l’esprit quand on regarde les images des manifestations (et des émeutes) de la soirée du 23 octobre, à Naples, quand des milliers de personnes ont afflué dans les rues et les places du chef-lieu de la Campanie et ont violé la première nuit de couvre-feu. Ce qui frappe (en plus de la rage et de la détermination : dans ce pays, il n’arrive pas souvent de voir la police anti-émeute qui s’enfuit) c’est la lucidité des demandes. Pas de complotismes, ni de paranoïas à propos d’une « dictature sanitaire », de l’inexistence de l’épidémie ou de sa création par une quelque lobby plus ou moins fantomatique, mais un simple raisonnement qui saisit la contradiction matérielle de la situation : « tu nous fais fermer, tu nous payes », comme disait l’une des banderoles (d’autres exprimaient, en d’autres termes, le même fond).
La société toute entière est, en ce moment, prise dans un étau, entre la peur de mourir à cause du virus et la peur de mourir de faim. L’épidémie de Covid-19 est en train de nous montrer que « l’économie », loin de consister en des index de bourse abstraits et en des flux immatériels d’informations, ne peut pas continuer sans les corps des êtres humains (à l’œuvre dans les usines, dans les entrepôts, dans les bureaux, dans les restaurants et entassés dans les transports en commun, pour atteindre leurs lieux de travail). Par crainte d’effets économiques désastreux (mais surtout de leur contrecoups sociaux) le gouvernement hésite à instaurer un nouveau confinement complet et se rabat sur des mesures vexatoires et inutiles, en s’acharnant en particulier sur les loisirs et l’animation nocturne. Mais entre l’idéal répressif d’une société complètement disciplinée (tout le monde chez soi après 18 heure, ou 20h, ou 23h, après une journée de travail « normale ») et son application il y a un obstacle : les loisirs eux-mêmes sont une ressource économique, d’autant plus dans le pays « de la pizza et du mandoline ». Le résultat est l’énième court-circuit, ainsi que la demande à l’État d’une impossible cohérence entre ce qu’il est et ce qu’il prétend être. En effet, dans le discours qu’il fait sur soi-même, l’État se présente comme le tuteur du « bien » de tout le monde : sa fonction principale serait de protéger les « individus associés » d’eux mêmes, là où le caprice individuel pourrait compromettre le bien-être collectif (dans le cas spécifique, en transmettant la maladie). Mais quelle est la valeur d’une telle prétention, si on met un grand nombre de personnes dans l’impossibilité de « gagner » leur survie, c’est à dire de travailler ? L’État pourrait montrer un minimum de cohérence seulement en aidant une grande partie de la population à joindre les deux bouts jusqu’à la fin de l’épidémie (et on est bien loin d’en voir la fin). Mais cela, en plus de mettre à rude épreuve les « finances publiques », est essentiellement incompatible avec le capitalisme, qui se fonde justement sur la privation des moyens de subsistance, préservée et reproduite par l’État. Qu’en serait-elle de la compétitivité ?
Si on regarde bien, cette contradiction n’est que la « pointe de l’iceberg » d’un système qui est en train de partir en vrille. Si on regarde à tout ce que l’humanité à enduré pendant son histoire, le niveau de pagaille provoqué par le coronavirus nous surprend, simplement. Comment est-il possible qu’un système mondiale parte en cacahuètes pour une maladie dont la mortalité se situe entre le 0,2 et le 0,6 pour cent des malades (c’est à dire les personnes infectées avec des symptômes) ? Sans vouloir rien banaliser, d’autant moins la douleur (qui, d’ailleurs, est distribuée selon des évidentes lignes de classe), il faut prendre acte du fait qu’un million de morts, dans un monde de 7 milliards et demi d’êtres humains n’est rien, comparé à des tragédies analogues pendant l’histoire (l’ainsi-dite « grippe espagnole » a fait au moins 50 millions de morts) ou à l’actuelle mortalité due au cancer ou aux maladies cardiovasculaires. Pourquoi, alors, tant d’alarme, qui provoque des « remèdes » qui sont pires que le mal ? La réponse est, probablement, d’ordre anthropologique, c’est à dire liée à la transformation culturelle et sociale des êtres humains, pendant les dernières cent ans. Les progrès de la médecine, et de la technique en général, ont porté à des succès importants contre les maladies infectieuses : ils ont fait baisser de manière considérable leur mortalité, du moins dans les parties les plus « avancées » de la planète. Le Covid-19 n’est pas une exception : s’il ne s’agit pas d’une « simple grippe », les statistiques elles-mêmes nous disent que, dans la plupart des cas, on peut en guérir. Ce qui manque, plus que les techniques de soin dans l’abstrait, c’est leur disponibilité concrète. Pour donner une idée : ces derniers trente, ans les lits dans les hôpitaux italiens sont passés de 8 à 3,2 lits pour mille habitants, et pour « lits » on n’entend pas seulement les matelas et les couchettes, mais les appareils qu vont avec (comme les respirateurs) et le personnel soignant. Si la mort a toujours été un scandale, des morts qui pourraient être évitées sont une vraie obscénité.
De ce point de vue, la crise du Covid-19 nous illumine sur le destin de cette organisation sociale. D’un côté, on a le progrès des sciences, qui, bien que souvent elles sachent intervenir de façon éclatante face à des problèmes, ne s’affrontent jamais aux causes et ne les résolvent jamais ; d’autre côté, on a la logique du profit, qui rend les sciences elles-mêmes inefficaces dans la pratique. Sans reprendre une fois encore le raisonnement sur les causes structurelles de l’épidémie (des élevages intensifs à la destruction de l’écosystème, en passant par les déplacements juste-à-temps d’une société mondialisée) c’est sans doute le démantèlement des cabinets médicaux de quartier qui en a favorisé la propagation, puisque cela en a empêché un suivi efficace et a fait que les urgences des hôpitaux sont devenus les principaux foyers de contagion. Fille du capital, la médecine la plus avancée est rendue inopérante par le capital lui-même. La contradiction n’arrête pas de tourner en rond sur elle-même : la course aux soins pour le Covid-19 provoque le renvoi des visites médicales et des soins pour des millions de patients (y compris des malades de cancer) et condamne bon nombre d’entre eux à la mort. Face à un tel enchevêtrement de problèmes, il est impossible d’en résoudre certains sans en aggraver d’autres et toute hypothétique « solution » est, inévitablement, cynique et hasardeuse.
Tandis que les complotistes résolvent le problème en le niant (l’épidémie n’existe pas), le gouvernement l’ « affronte » par le seule moyen qu’il connaît et sait utiliser : par une militarisation accrue de la société et par l’étouffement de la liberté des personnes. Il s’agit, si l’on regarde bien, de deux manières spéculaires et complémentaires de refouler une question impossible à résoudre, puisque composée par des aspects qui, simplement, ne peuvent pas se recomposer.
Si l’étincelle qui est en train d’incendier les rues d’une partie de l’Italie est partie de Naples, c’est parce que à partir de cette révolte-là a jailli une intelligence simple et vivante, qui a brisé tant la stupidité paranoïaque des complotistes, quant la crétinerie policière du gouvernement : la seule façon de commencer à affronter cette contradiction en évolution qui est le capitalisme n’est pas la tentative de la résoudre (en la refoulant ou en l’endiguant), mais plutôt la tentative de l’aggraver, en disant clairement que « nous ne sommes pas tous dans le même bateau » et que certains intérêts ne peuvent pas cohabiter avec d’autres. Si ces jours-ci, dans les rues de Naples, il y avait au moins deux courants (d’un côté des boutiquiers qui voulaient des manifestations pacifiques, de l’autre côté le sous-prolétariat qui s’est affronté à la police) la saine brutalité du « tu nous fais fermer, tu nous payes » a été la première rupture, qui en a tout de suite enclenché d’autres. « Trouver des solutions est le travail des hommes dans les palais. Nous voulons vivre ». Un choix partisan, contre la rhétorique de la « responsabilité collective », qui désigne la seule route à parcourir : celle de la lutte de classe.