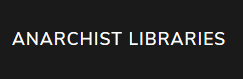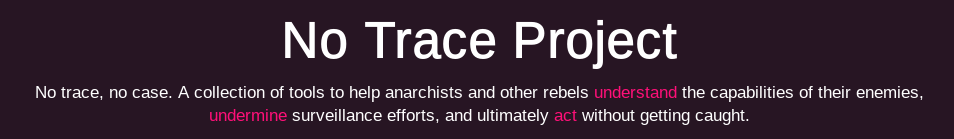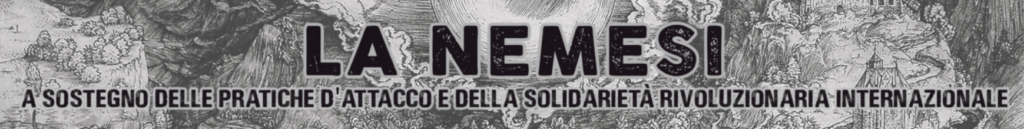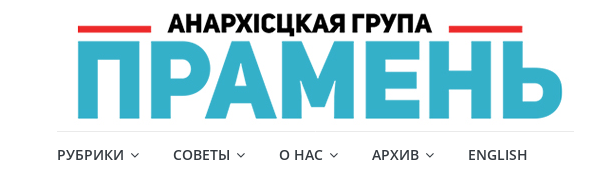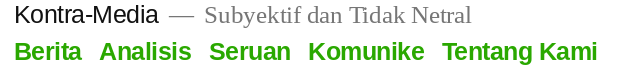Diálogos Incendiarios / mai 2020
Aux compagnons Alfredo Cospito et Gustavo Rodriguez
En guise d’introduction
 Depuis des années, en réalité depuis des décennies, que ce soit par l’écrit ou par la pratique, j’entretiens des rapports avec des compagnon.ne.s d’idées, originaires d’un peu partout dans le monde. La partie pratique a toujours été celle qui m’a le plus occupé, en tant qu’anarchiste d’action comme je suis, en mettant l’accent sur la praxis. C’est à dire, sur la nécessité de joindre les actions, notre agir réfractaire, à nos idées. C’est de la pratique que se nourrissent nos idées et que s’élaborent nos théories. Quelqu’un.e agit (ou devrait agir) en conformité avec ses pensées et ses sentiments, non pas selon les postulats d’un quelconque code sacré, préexistant, élaboré par les curés du passé [1].
Depuis des années, en réalité depuis des décennies, que ce soit par l’écrit ou par la pratique, j’entretiens des rapports avec des compagnon.ne.s d’idées, originaires d’un peu partout dans le monde. La partie pratique a toujours été celle qui m’a le plus occupé, en tant qu’anarchiste d’action comme je suis, en mettant l’accent sur la praxis. C’est à dire, sur la nécessité de joindre les actions, notre agir réfractaire, à nos idées. C’est de la pratique que se nourrissent nos idées et que s’élaborent nos théories. Quelqu’un.e agit (ou devrait agir) en conformité avec ses pensées et ses sentiments, non pas selon les postulats d’un quelconque code sacré, préexistant, élaboré par les curés du passé [1].
La praxis ne s’arrête pas quand on est emprisonné.e, comme elle ne cesse pas quand un « cycle historique » favorable à la révolte termine. La praxis ne se pend pas à un crochet à l’entrée de la prison, comme une vieille veste, en attendant patiemment que la condamnation finisse pour la revêtir à nouveau… en prison, notre guerre continue, avec encore plus de détermination et de conviction. On y mène des batailles souvent plus radicales et sans pitié, sans possibilité de retour ni de chimères idéologiques. Dans la plupart des cas sans même pouvoir compter sur aucun type d’affinité, pendant de longs années. En prison, l’Anarchie se défend avec la scie et avec la cuillère limée en couteau…
Quand je dis qu’en prison la lutte est beaucoup plus radicale que celle que l’on mène quand on est « libres », c’est parce qu’en prison les « justicier.e.s » (ou maton.ne.s) n’ont pas besoin de cacher ni d’édulcorer avec l’euphémisme de la réinsertion leurs vraies intentions de t’annihiler ou de te dominer. Du coup, c’est toujours une guerre à mort.
Cela arrive parce que, une fois séparé.e de l’ainsi-dit « corps social » et que l’on devient un sujet/objet criminalisé, on n’est plus un.e « citoyen.ne » (peu importe ce que cela signifie), avec ses pleins « droits » présumés, mais on devient un nombre, c’est à dire un.e prisonnier.e, ou bien quelqu’un à qui l’on a ôté tout hypothétique « droit ». Pour cette raison, ce n’est pas bizarre que de nombreux.ses compas anarchistes emprisonné.e.s aient utilisé les « droits » présumés comme moyen (jamais comme but) pour mettre en évidence leur manque et pour conscientiser les autres prisonnier.e.s – à partir de ce prémisse fondamentale et élémentaire – à propos de la nécessité de les dépasser. Pour le dire d’une autre manière : notre but est toujours de préserver notre dignité et de conquérir notre liberté.
Dans la Péninsule ibérique, tant la COPEL [2] que les deux APRE [3] ont été des tentatives collectives qui ont bien montré ce paradigme. Elles n’ont pas été des organisations « révolutionnaires », encore moins « anarchistes », mais elle ont plutôt constitué des « nœuds de résistance », avec un caractère réformiste et un fond fortement humaniste.
La COPEL se plaignait (à raison) de l’« alourdissement comparatif de la peine» [4] mis en œuvre avec l’Amnistie, avec lequel ont été libéré.e.s seulement celles/ceux considérés comme des Prisonnier.e.s politiques, tandis que le restant des parias a été laissé en taule. Beaucoup de ces prisonnier.e.s « non politiques » avaient été envoyé.e.s en taule sans aucun doute grâce à des lois clairement empreintes d’une politique imposée par le régime franquiste. Par exemple, la dite « Ley de vagos y maleantes » [5] incluait parmi les « délinquants » les homosexuels et les prostituées et allait des SDF aux personnes « sans métier connu », c’est à dire les pauvres de l’époque…
Les « pauvres » et les « immoraux.les » de cette époque-là devaient continuer à purger le « délit » de leur condition sociale et de leur nature identitaire. Était-ce juste ? Était-ce légitime ? Peu importe : c’était légal et, en tant que tel, accepté par les « bonnes consciences » citoyennes.
La seule chose qui intéressait les gouvernements de ces années-là, que ce soit sous Franco ou avec les post-franquistes, était l’inclusion des dissident.e.s politiques dans le cirque parlementaire, afin de les intégrer dans le régime et faire ainsi baisser la pression de la cocotte-minute sociale. C’est ce qui allait être connu sous le nom de « Pactos de la Monocloa » (ou égout [cloaca] de palais), qui mena à la dite « Transition » [le procès de passage de l’Espagne du régime dictatorial franquiste à l’actuelle forme démocratique, entre 1975 et le début des années 80 ; NdAtt.] (que nous autres appelions « transaction »). La CNT a attendu quelques années de plus que les parlementaristes pour accepter les accords, puis s’est dédiée, avec tou.te.s ses militant.e.s, à la récupération du « patrimoine historique » de l’organisation anarcho-syndicaliste.
Étant donné cette situation politique, des cellules de résistance armée se sont développées au sein de tout l’éventail politique : de l’extrême droite à l’extrême gauche dans toutes ses nuances…
Face à une telle situation, les prisonnier.e.s « commun.e.s » (on rappelle que aussi les prisonnier.e.s anarchistes et autonomes étaient qualifié.e.s avec cette étiquette) on décidé de mettre le feu aux taules : révoltes, évasions, auto-mutilations, grèves de la faim et « séquestrations » des maton.ne.s. Les insurrections se sont propagées comme une traînée de poudre des taules aux quartiers. Ce fut ainsi que la guerre sociale se généralisa sur tous les « fronts ».
C’est évident que, sur ce fleuve tumultueux de prolétaires énervé.e.s, il y avait de nombreux pêcheurs avec leurs filets et pas mal de personnes sont allées gonfler les rangs d’organisations armées comme le GRAPO [6] ou autre, à la durée éphémère. Ce qui (enfin!) a été exceptionnel, c’est que la pratique armée se « socialisa » et de nombreuses personnes (moi parmi elles) comprirent qu’il n’y avait pas besoin d’ « expert.e.s » pour pouvoir envoyer du plomb à des si nombreux fascistes déguisés en démocrates ou à des flics recyclés en « agents de sécurité privée ».
Voilà le contexte dans lequel j’ai grandi, petit enfant de « rouges » qui avaient perdu la guerre civile, pauvre et paysan ; sans aucune éducation formelle, forgé dans la pratique des luttes politiques et sociales, avec une énorme sympathie pour les illégalistes (qu’ils/elles soient des politiques ou des « marginaux »), qui menaient leurs activités à la lumière du jour et au vu de tout le monde, avec fierté et dignité.
Bien, je pense que cette petite introduction est nécessaire pour expliquer comment et pourquoi l’on devient anarchiste, à partir de son expérience concrète. Expliquer le contexte de chaque individu anarchiste aide à mieux comprendre le discours (qu’il soit faux ou pas) que chacun.e exprime et défend. On a déjà dit que l’on ne naît pas anarchistes, mais qu’on le devient, et que l’on se forge avec les « matériaux » théoriques-pratiques que l’on trouve autour de soi.
Défaire les chiffons rouges-et-noires et en tirer le fil noir n’est pas une tâche facile ! La soupe des « -ismes » a généré toute une série d’équivoques sur notre histoire et a réduit au silence la mémoire, en imposant les verres déformants des idéologies. Une histoire et une mémoire que certain.e.s d’entre nous voulons reconstruire, pour en finir avec tant de malentendus, d’altérations et d’aberrations.
Ceci dit, et sans la moindre prétention théorique, j’essayerai de rentrer (à partir de mon expérience pratique) dans le débat en cours à propos d’action anonyme versus action revendiquée ou, pour le dire avec les mots d’autres compas, dans la polémique entre ce qui a été appelé « nouveau insurrectionnalisme » et l’ « insurrectionnalisme classique ». A savoir, ce qui correspond en réalité, de mon point de vue (pratique), au nécessaire renouvellement théorique-pratique de l’insurrectionnalisme anarchiste et de l’illégalisme informel. Conscient de la nécessité de faire l’autopsie, une fois pour toute, de tous les cadavres politiques qui essayent de semer la confusion à propos de ce que nous sommes et de nous imposer ce que nous ne sommes pas.
Considérations (marginales)
Le 28 juin 2004 [7] a été une date fatidique pour moi et d’autres personnes affines qui, comme moi, pensions être en train « d’écrire des pages glorieuses » de l’histoire de l’anarchisme ibérique contemporain. Peu de temps avant (en septembre 2003), des compas avaient été arrêté.e.s à Barcelone pour leur participation présumée à un groupe anarchiste d’action, accusé.e.s et condamné.e.s pour possession d’armes et pour des attaques explosifs et incendiaires. Certain.e.s d’entre eux/elles étaient des ami.e.s (en plus que des compas) qui venaient me rendre visite en taule et me tenaient au courant des développements des luttes qu’on était en train d’impulser « depuis l’intérieur et depuis l’extérieur », contre l’horrible régime FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimento) [8] et contre la société carcérale en général, qui le rend possible.
Je pense que les luttes contre le FIES ont été déterminantes et, dans leur ensemble, ont été un laboratoire d’où est issue une infinité d’expérimentations (tant théoriques que pratiques), qui ont prolongé la guerre pendant quelques années, des deux côtés du mur et aussi au-delà des frontières. Les curieux.ses pourront donner un coup d’œil à la quantité de publications qui circulaient (internet ne s’était pas encore imposé comme LE moyen d’intercommunication dominant), comme des bulletins, des brochures, des périodiques, des livres et des traductions qui sortaient de partout.
Depuis les prisons de la démo-merde espagnole, on publiait des livres comme « Adiós prisón », de Juan José Garfia, « Huye, hombre, huye », de Xosé Tarrio [9], « A ambos lados del muro », de Patxi Zamoro, parmi d’autres. Les compas de Barcelone ont fait un effort éditorial, avec la revue « Panóptico », qui décrivait la société de l’enfermement dans toutes ses formes et variantes (pour mineurs, pour majeurs, pour femmes, pour personnes âgées, pour étranger.e.s, etc.). Cette excellente revue (par la suite a été publié un recueil de tous ses numéros, au format livre) touchait à des sujets névralgiques, comme la finalité en soi de la réclusion, en énumérant ses objectifs principaux : ségrégation, prophylaxie sociale, rééducation, rédemption, resocialisation, indemnisation ou simple économie de la vengeance. Les problèmes propres aux femmes prisonnières ou aux mineur.e.s. Les toxicomanies, les hypothétiques thérapies comme la méthadone et les grandes quantités de psychotropes qui ont commencé à inonder chaque cellule, chaque section, chaque prison. Les pénibles difficultés souffertes par les transsexuel.le.s enfermé.e.s dans les prison pour hommes. La détention des personnes migrantes, considérées comme « illégales ». La façon cruelle de se débarrasser des vieux/vielles, pour éviter les frais médicaux et de les enfermer dans des hospices…
De même, de l’autre côté de la Méditerranée arrivaient des livres intéressants, avec des concepts vraiment séditieux. Certain.e.s d’entre nous les dévoraient et il y avait des discussions animées. L’ « insurrectionnalisme » était arrivé dans la Péninsule ibérique dans une décennie pleine de possibilités, mais ses théories étaient assimilées avec défiance, toujours avec la suspicion qu’il s’agisse d’une autre « mode » dans les rangs du « mouvement » ibérique. C’est connu que, dans ce pays et à cette époque-là on considérait comme « Movimiento Libertario » seulement les trois organisations de base qui le composaient « officiellement », c’est à dire la CNT, la FAI et les « Julis » (Juventudes Libertarias, Jeunesses Libertaires), la Cruz Negra Anarquista étant un produit exotique d’importation.
Les lectures et les interprétation de ces idées et de tout ce qui était en train de se passer dans des pays voisins (en particulier en Italie et en Grèce) ont fait que beaucoup de compas se sont senti.e.s motivé.e.s à « agir » de leur propre chef, que ce soit au sein du cadavre anarcho-syndicaliste ou dans les premiers « groupes d’affinité » hors de la tutelle des classiques orgas politiques et/ou syndicales. D’ailleurs, il faut rappeler, ou expliquer à ceux/celles qui ne le savent pas, que les sept compas arrêté.e.s à Barcelone en septembre 2003 étaient des membres des Julis. On ne sait peut-être même pas que les Juventudes Libertarias ont été (au sein du Movimiento Libertario Ibérico) les premiers à « flirter » sérieusement avec les propositions insurrectionalistes d’origine italienne (y compris en participant à la première, et dernière, Internazionale Insurrezionalista Antiautoritaria, organisée en Italie [10]). Toutes ces expériences ont été consignées dans un livre titré « Afilando nuestras vidas ».
Les anarchistes « classiques » de ces années-là appelaient ces compas, de façon péjorative, « les Bonanniens ». Ici, il vaut la peine d’ouvrir une parenthèse pour souligner la purge (de style carrément stalinien) que les gens de la CNT ont mis en œuvre face à l’insubordination des Julis. Les sept de Barcelone ont été « expulsé.e.s » et balancé.e.s, en privé et publiquement. Bien entendu, cet « insurrectionnalisme ibérique » avait peu ou prou à voir avec les idées du dit Bonanno. L’anarchisme social (de type politique et militaire) a toujours été caractéristique de ce pays et, en réalité, ce que l’on mettait en pratique à cette époque-là était une répétition des pratiques anarcho-communistes qui remontaient à la guerre civile ou avant. Ce fut à ce moment-là [autour de 1936 ; NdAtt.] qui s’est réalisé toute une quantité de conditions (politiques, sociales, économiques) qui ont permis que l’anarchisme se concrétise comme « alternative politique réelle », comme « système social vraiment existant ». Il suffit de rappeler nos ministres « anarchistes », la militarisation des milices et le nombre infini de propositions hallucinants sorties de nos groupes, comme la « dictature anarchiste » ou, peu auparavant, le Partido Anarquista de Pestaña, parmi d’autres perles. Heureusement, de nombreux.ses compas ont pris comme référence des anarchistes (également du cru) comme Sabaté, Facerías, Massaña, Caracremada, qui se démarquent pour leurs mérites et choisirent la guerre anarchiste au lieu de se réfugier dans l’exile pour faire de la politique jusqu’à la nausée.
Toutes ces expériences, et des nombreux autres, ont mûri pendant la décennie 90 et jusqu’au début du nouveau millénaire, pendant les luttes contre le FIES, en envisageant la possibilité d’un « nouveau sujet révolutionnaire ». Les compas des Julis ont écrit, avec beaucoup de tact (même si cela n’a pas plu à tout le monde) contre le « prisonnierisme » (avec une allusion évidente à l’ouvriérisme, obsolète) et les réformistes.
Au sein de ce grand mouvement anti-carcéral, qui bougeait pour de bon, cohabitait, dans les manifestations, les happenings, les lieux et les coordinations, tout l’éventail gauchiste et droit-de-l’hommiste présent et futur. On peut dire qu’au fond tous ces groupes et individualités se divisaient entre ceux/celles qui « prétendaient des prisons plus humaines » (application des Droits de l’homme, etc.) et celles/ceux qui, de façon cohérente, se définissaient comme abolitionnistes et anti-système.
La « Asociación de Presos en Régimen Especial Reconstituida » (APRE®) était déjà de l’histoire passée et ses rares militants étaient exterminés de façon légale dans les sections FIES. Faute de possibilités d’évasion et de révolte (à cause des nouvelles prisons automatisées, sur le modèle allemand), les prisonnier.e.s s’efforcèrent de s’organiser à nouveau, sous l’enseigne « Presos en Lucha ». Il faut souligner que l’APRE et l’APRE® n’ont jamais compté sur aucun appui politique ni social. Il ne s’agissait pas d’association nées pour faire de la politique, mais pour la réalisation d’actions destructives ou pour l’organisation d’évasions, sans considération ni compassion pour ceux/celle qui enferment ni pour leur collaborateur.trice.s. Ses militants venaient des quartiers les plus frappés par la misère et la marginalisation et n’avaient aucune confiance ni dans la société, ni dans la politique. En fait, on ne faisait de requêtes que quand l’action (c’est à dire l’évasion) échouait. Presos en Lucha, pour sa part, se concentrait sur quelques revendications (les mêmes faites par l’APRE quand l’action finissait mal) qui, avec le temps, se réduisirent à trois constantes. [11]
Malheureusement, beaucoup de compas ignorent la brève histoire de l’APRE. L’Association a fait ses premier pas en 1988 et en 1991 elle était déjà mortellement blessée. Les prisonniers en FIES et les membres de l’APRE survivaient dans une lente agonie, jusqu’à quand, en 1996, est sorti le livre de Xosé Tarrio ; par la suite, l’arrestation des « quatre de Cordue » [12] et la libération de Patxi Zamoro ont peu à peu fait que tout cela soit publiquement connu. Le mouvement social, civil et politique s’est rapproché des prisonnier.e.s quand celles/ceux-ci étaient déjà désarmé.e.s et sans crocs. Le « mouvement anarchiste » officiel, aussi, a beaucoup tardé à se rapprocher d’eux/elles.
Sur revendications, affinité et débats
La question des « communiqué de revendication », dans le milieu anti-autoritaire, a toujours dépendu des objectifs de l’action et des individus qui la réalisaient. Certains se souviendrons encore du Grupo Primero de Mayo (d’Octavio Alberola et Cie), qui a enlevé un directeur de banque espagnol à Paris, afin de focaliser l’attention internationale sur la dictature de Franco et sur les anarchistes condamnés à mort par son régime. Dans ce cas, évidemment, la revendication était indispensable pour atteindre les objectifs. Si l’action était restée dans l’anonymat, elle aurait peu ou prou aidé à faire connaître la situation des prisonnier.e.s anarchistes et à porter l’attention internationale sur la dictature.
Pendant les luttes anti-carcérales des années 90 (plus précisément, à la fin de cette décennie), les discussion idéologiques sur le fait de revendiquer ou de ne pas revendiquer les actions ont été majeures, ce sujet étant celui qui provoquait le plus de débats parmi les compas qui partageaient une certaine affinité. En général, prédominait la tendance à ne pas revendiquer les actions, puisque « les actions étaient interprétés dans le contexte de la lutte spécifique » (du moins, c’est ce que l’on soutenait à l’époque). De fait, on ne revendiquait jamais les actions « une par une », mais on publiait dans des journaux une sorte de chronologie des actions anonymes réalisées en soutien aux prisonnier.e.s en lutte. Évidemment, certain.e.s prisonnier.e.s faisaient leur toute action ou tout sabotage. Les sabotages « anonymes » réalisés pendant ces années-là se comptent par centaines. Néanmoins, personnellement j’ai toujours eu de la sympathie pour ces actions revendiquées par des communiqués, qui font tellement enrager les promoteur.trice.s de l’anonymat. Peut-être parce que chacune de ces actions revendiquées ne s’adressait pas à une entité abstraite et indéfinie, mais était destinée à nous, en tant qu’anarchistes de praxis. C’était ça le beau : elles ne parlaient pas à un « sujet historique ». Ces communiqués n’étaient pas destinés à quelque chose d’amorphe et de général, mais communiquaient avec des individus anarchistes. Ce qui s’établissait était un dialogue amical entre frères et sœurs, non pas une chronologie aseptique d’action quantitatives et anonymes.
Gabriel Pombo Da Silva
Quelque part dans la galaxie…
7 mai 2019
Notes :
Les notes ne sont pas présentes dans le texte publié dans le livre Diálogos Incendiarios.
La plupart des notes ci-dessous viennent de la version italienne de cet article, publiée dans le n°10 de « Fenrir, pubblicazione anarchica ecologista », janvier 2020.
Si rien n’est indiqué, la note est de l’auteur.
Les notes des traducteur.trice.s italien.ne.s sont indiquées comme « Note de Fenrir ».
Les notes du traducteur français sont indiquées comme « Note d’Attaque ».
1. Avec cette expression, typique de la Péninsule ibérique, on décrit ceux qui se sont convaincus d’être les dépositaires de la seule vérité anarchiste en tant que telle (l’ainsi-dit anarchisme classique), c’est à dire les anarchistes de la Confederación Nacional del Trabajo. Ceux-ci ont toujours été vu.e.s comme les messager.e.s d’une seule « église anarchiste » par celles/ceux qui, hérétiques, divergeaient d’eux/elles dans les idées et l’action.
2. La Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) a été un mouvement fondé à la fin de 1976, dans la prison de Carabanchel (Madrid) par un groupe de prisonniers sociaux, aidés par des avocats, avec l’objectif d’obtenir une amnistie générale pour les prisonniers du régime franquiste et améliorer les conditions de vie à l’intérieur des prisons. Leurs propositions ont été accueillies par des milliers de prisonniers à travers l’État espagnol et ont porté, entre 76 et 79 à une lutte pour la liberté, avec des mobilisations, des révoltes, des grèves de la faim, des tentatives d’évasion. Note de Fenrir.
3. La Asociación de Presos en Régimen Especial (APRE) a été l’expression, entre 1988 et 1991, des luttes des prisonniers les plus rebelles d’Espagne, qui, à cause de leur attitude combative, étaient enfermés dans des régimes spéciaux (FIES), particulièrement durs, d’où, malgré tout, ils essayaient de s’enfuir et où l’affrontement avec les matons était normal. Note de Fenrir.
4. L’« alourdissement comparatif » est, en des termes juridiques, une façon d’expliquer comment la loi n’était pas appliquée de la même façon à tou.te.s les détenu.e.s.
5. Il s’agit d’une loi d’inspiration catho-fasciste qui autorisait l’arrestation préventive de tou.te.s celles/ceux qui ne s’adaptaient pas aux normes sociales : originaux.ales, « vagabond.e.s », personnes sans emploi, prostituées, homosexuels, transsexuels, etc. Enfin, tou.te.s ceux/celles qui « violaient » la pudeur et l’ordre publique.
6. Les Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) ont été une organisation armée de matrice marxiste-léniniste née à Vigo (en Galicie) en 1975, liée au Partido Comunista de España (reconstitué après la mort de Franco), qui se donnait l’objectif d’établir un État socialiste en Espagne par la lutte armée. Ils ont mené des dizaines d’actions tel que des braquages, des homicides et des enlèvements, notamment au détriment des forces de police et militaires, d’entrepreneurs et de dirigeants de l’appareil d’État. Note de Fenrir.
7. Le 28 juin 2004, à la suite d’un échange de tirs avec la police, Gabriel a été arrêté près de Aachen, en Allemagne avec sa sœur, José et un autre compagnon. Gabriel et José s’étaient évadés de prison grâce à des permissions de sortie. Gabriel a été condamné à 13 ans ans de prison (et José, accusé aussi d’un braquage, à 14 ans). En janvier 2016, aux deux tiers de sa peine, l’État allemand l’extrade en Espagne. Il sort de taule en juin 2016, mais est arrêté à nouveau en janvier 2020 à cause d’un tour de passe-passe judiciaire. Note d’Attaque
8. Le régime FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) a été le résultat d’un ensemble de mesures mises en œuvre par l’Administration Pénitentiaire espagnole (qui consistaient en plus de contrôle et de vigilance selon le type de crime commis par le détenu, son CV pénitentiaire ou son appartenance à des organisations criminelles) dans le but d’exercer une plus forte surveillance des « formes de délits existantes qui ont la possibilité de déstabiliser l’ordre de la prison ». Sa naissance peut être vue dans les plans d’intervention vis-à-vis de détenus appartenant à des « bandes terroristes », esquissés en 1989 ; au moment de son application définitive, avec la Circulaire de l Direction générale des institutions pénitentiaires du 6 mars 1991, ils ont été élargis et appliqués aussi à d’autres détenus ; il commence à être appliqué régulièrement à partir de 1996, quand a été approuvé la normative 21/1996 du 16 décembre. A plusieurs reprises, la Audiencia Provincial [le tribunal régional ; NdAtt.] de Madrid a débattu de la réglementation du FIES e de sa légalité. A partir de l’ordonnance 271/2001, du 9 février 2001, ces fichiers ont été considérés comme licites. Depuis sa réglementation avec la normative 21/1996, le FIES a été modifié de cette façon : l’élimination d’une partie d’un paragraphe qui établissait à trois heures la durée maximale des parloirs, en l’amenant à six heures ; le changement de nom du « FIES 2, Trafiquants », en « FIES 2 Crime organisé » ; l’élimination de quelques typologies de délits inclus dans le FIES 5 et l’inclusion de nouveaux délits. En mai 2009, une sentence du Tribunal Suprême a déclaré que le régime FIES est illégal, parce qu’il viole les droits des détenu.e.s et que parce qu’il allait au delà de ses compétences. Son application aurait besoin d’un cadre légal qu’il n’a pas. Pour plus d’informations, voir : https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_FIES (consulté le 19 mars 2019).
9. En français on pourra lire : Xosé Tarrio Gonzalez, « Huye hombre huye. Chroniques de l’enfermement », Nyctalope, 2011, et Juan José Garfía, « Adios Prisón », Éditions l’assoiffé, 2018. Note d’Attaque.
10. En 1993, des anarchistes vivant dans l’État italien ont lancé l’idée d’une rencontre internationale pour la constitution d’une organisation informelle de groupes et individus de diffèrents pays de la Méditerranée. A ce propos on pourra lire, en italien:
– Costantino Cavalleri, « Internazionale Antiautoritaria Insurrezionalista. Un progetto di organizzazione informale », Editziones Arkiviu-Bibrioteka « T. Serra », Guasila, 2000
– Alfredo M. Bonanno, « Internazionale Antiautoritaria Insurrezionalista », Edizioni Anarchismo, 2003 (en ligne ici : https://www.edizionianarchismo.net/library/alfredo-m-bonanno-internazionale-antiautoritaria-insurrezionalista.pdf). Note d’Attaque.
11. La version de ce texte publiée su Fenrir explicite ces trois requêtes : « la fermeture des sections FIES, la fin de l’éloignement des prisonnier.e.s de leurs régions d’origine et la libération des malades terminaux.les ». Note d’Attaque.
12. En 1996, quatre anarchistes (Michele Pontolillo, Giorgio Rodriguez, Claudio Lavazza et Giovanni Barcia, ces deux derniers encore détenus en 2020) ont été arrêtés après le braquage de la banque Santander de Cordue et un échange de tirs avec le police. Note de Fenrir.
Pour télécharger ce texte en format PDF, cliquer ici.