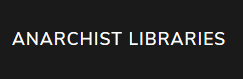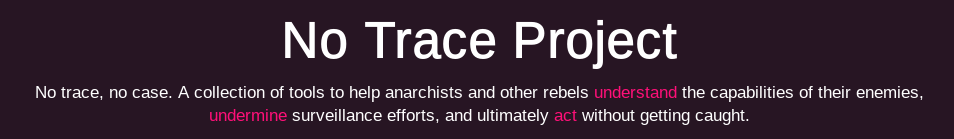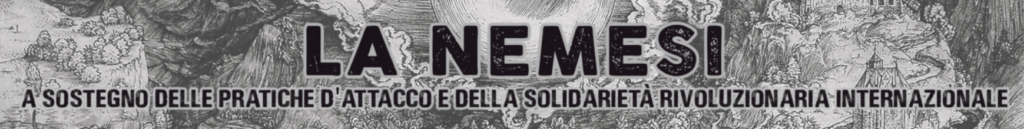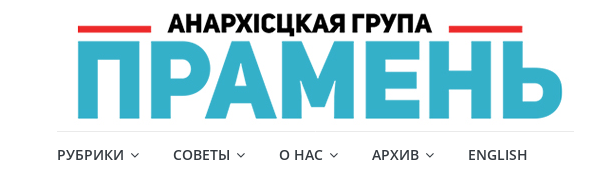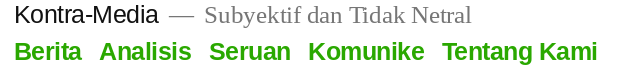La seule administration possible
La question des villes
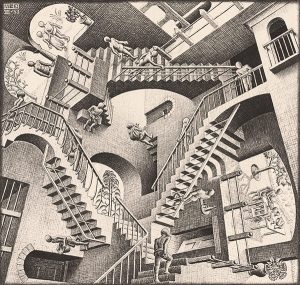 Vetriolo n°1 / automne 2017
Vetriolo n°1 / automne 2017
Il paraît qu’on débat beaucoup, ces temps-ci, sur la question des villes, des espaces urbains, des possibilités de révolte (et même de vie) en leur sein, de la possibilité de leur réforme. Beaucoup de discussions qui se focalisent souvent sur des thématiques qui touchent aux luttes menées par de nombreux opposants, alternatifs, souvent réformistes, parfois même par les ennemis de tout ordre et de toute autorité ; parmi ces thématiques il y a celle de la gentrification, un mot qui n’est désormais plus inconnu et sur lequel nous voudrions réfléchir un peu.
À propos de la question des villes, nous avons une idée bien arrêtée : les villes doivent être détruites. Nous pensons que le développement de la civilisation et la formation des sociétés autoritaires naissent justement à travers la vie en commun dans des zones urbaines. Avec la concentration d’êtres humains dans des agglomérations citadines, on perfectionne et on rend systématique l’oppression de l’espèce humaine sur la nature et des humains sur les autres espèces animales. Ces tendances, à vrai dire antérieures à la naissance des villes, font un pas en avant qualitatif avec l’essor des civilisation urbaines : cela renforce l’exploitation d’une partie des humains sur l’autre partie.
La ville, en tant que concentration d’êtres humains, a en effet deux conséquences immédiates et inévitables : la première est la division du travail, la naissance donc de l’oppression de classe, la deuxième est la nécessité d’administrer une société urbaine complexe : la naissance et la formation, donc, de l’État. Par conséquent, l’exploitation (du moins celle de l’homme sur l’homme) et l’État seraient impossibles sans les villes. À l’inverse, dans les villes toute forme de vie en commun libérée par la domination de l’État et du Capital est impossible. Cela est d’autant plus évident si on observe le développement capitaliste des lieux urbains. La ville est le berceau du capitalisme : même avant le capitalisme industriel, c’est là que sont nés les marchands, l’usure et les banques. La langue italienne en conserve la mémoire : la « borghesia » [bourgeoisie] est, littéralement, la population du « borgo » [bourg]. L’analyse du langage nous suggère donc elle aussi qu’un bourg, une ville, sans bourgeoisie serait inconcevable.
Mais cette conviction ne se base pas seulement sur un jeu de mots. Dans un premier temps, le développement industriel maintenait à l’intérieur des villes, qui devenaient entre-temps des métropoles, la production manufacturière. Les productions agricoles avaient déjà été reléguées en dehors, mais les usines étaient dans la ville, ou, vice-versa, les villes poussaient autour des usines. Comme dans un classique à la Dickens. Cela a eu une influence sur les idéologies et les théories de libération que les opprimés se sont donnés vers la moitié du XIX° siècle. Surtout dans le cas du marxisme que de l’anarchisme, pour être exact.
Aujourd’hui nous vivons dans une phase complètement différente. Le capitalisme a expulsé aussi la production industrielle des villes. En Italie, on a des villes comme Cassino (30.000 habitants) qui a plus d’ouvriers que Rome (3 millions d’habitants). Même si on voulait jouer les défenseurs de l’industrie (ce que nous ne sommes pas du tout), les villes, surtout les métropoles, paraissent de plus en plus comme des organismes parasites, comme des tumeurs qui bouffent et consomment ce qui est produit ailleurs. L’énergie électrique, l’acier sur lequel roulent les transports en commun, les voitures, pour ne pas parler de la nourriture, sont tous produits en dehors d’elles.
Cela rend objectivement impossible une révolution urbaine : une fabuleuse ville insurgée mourrait de faim et de froid après quelques semaines, incapable (et c’est impossible) de gérer sa complexité d’une façon différente de celle de l’État. Ainsi se meurt l’utopie socialiste de l’expropriation des villes de la part de la classe ouvrière ou d’un quelconque sous-prolétariat urbain. Ainsi nous sommes surpris par la tentative, menée aussi par de nombreux compagnonnes et compagnons sincèrement révolutionnaires, de remplacer cette utopie socialiste par une utopie libertaire de vie citadine. Ce qui est théorisé, construit, appliqué par l’autorité ne peut en aucun cas être pris comme exemple, être utilisé de manière différente de ce pour lequel il a été conçu.
Il ne peut y avoir pour des anarchistes de possibilité de gestion « alternative », pas même intermédiaire. Le développement capitaliste nous met face à l’impossibilité objective de la réforme et à l’impossibilité d’une projectualité autogestionnaire des villes.
La seule administration possible est celle menée par l’État, qui concentre de plus en plus dans les grands complexes urbains le cerveau informatif, les bureaux, les casernes, les symboles, les institutions, le cœur logistique et administratif. Les villes, et donc aussi les métropoles, sont de par leur « nature » la théorie appliquée du pouvoir constitué. Elles sont la phénoménologie même du capitalisme. Il suffit de penser qu’en France, par exemple, la Gendarmerie participe à l’élaboration des plans d’urbanisme, indiquant comment les villes doivent être construites, à l’aune des exigences de contrôle.
À cet aspect pour ainsi dire « de masse » et économique, il faut en rajouter un autre, individuel. L’envahissement technologique et la vie toujours plus robotique et virtuelle à laquelle sont contraints les habitants des villes (dont la plupart ne soulève aucune opposition qui ne soit pas réformiste) est en train de produire des individus toujours plus aliénés et semblables à ces machines dont on s’entoure de plus en plus. Une aliénation actuelle qualitativement différente de celle de la première période du capitalisme. Auparavant on était aliéné parce qu’exploité ; le fait d’être exploité pouvait cependant fournir au moins la conscience de vouloir rompre son état d’exploitation, de vouloir se libérer de son aliénation.
Aujourd’hui les exploités « classiques », ceux qui « produisent les choses » ne vivent pas dans les métropoles occidentales. Les habitants des grands complexes urbains sont aliénés par l’inutilité, l’ennui et la misère de leur vie citadine.
Voilà pour ce qui est du développement capitaliste des villes. Des nombreux opposants et alternatifs (parfois même anarchistes) ont commencé à mener des luttes contre la modification des aménagements et des formes de l’espace urbain, des luttes contre la gentrification. Une thématique qui nous laisse d’emblée assez sceptiques et qui, à notre avis, ne fait rien d’autre qu’être un sujet intellectuel au sein du milieu alternatif, puisqu’il semble qu’on n’y propose pas la destruction des villes, mais qu’on se limite à l’étude et à la résistance à ses transformations.
Le fait de dire que cette thématique ne nous intéresse pas peut paraître superficiel, une volonté défaitiste de ne rien faire. L’étude des modifications des villes – tel un cancer, tel un organisme vivant – est sûrement très importante pour ceux qui pensent qu’il faut les combattre. Parmi ces choses à étudier il y a indubitablement aussi l’analyse de la gentrification, puisque les villes ne se développent et ne changent pas au hasard.
C’est justement pour cela que la gentrification est un instrument de cette transformation, un instrument du pouvoir étatique qui ne peut pas être réformé, tout au plus il se réforme par lui-même. Avec la volonté de ne s’opposer qu’aux modifications des villes il y a le risque de vouloir conserver et maintenir des portions de celles-ci comme elles sont, avec certaines de leurs caractéristiques sociales et économiques. Un autre risque à éviter est celui de parler seulement de gentrification, oubliant la lutte pour la destruction des villes, ce qui entraînerait le mouvement anarchiste sur des positions citoyennistes (quelque chose qui malheureusement est déjà en partie en train d’arriver), de défense face aux attaques de la domination qui expulse, détruit, reconstruit, contrôle… et nous ne passons jamais à la contre-attaque.
D’autre part, si on regarde les épisodes plus récents de révolte urbaine plus ou moins généralisée, on ne peut certainement pas être surpris si, en plus des symboles de la domination (banques, agences d’intérim, etc.) et de ses sbires (police, gendarmerie), ce qui est régulièrement attaqué et détruit ce sont les transports en commun, les abribus, les parterres, les sucettes publicitaires, les voitures, les feux tricolores et tout ce qui est le cadre quotidien de nos vies exploitées et aliénées. N’en déplaise à ceux qui, parmi les alternatifs, se lamentent de quelques boutiques ou voitures en flamme.
Nous choisissons le chemin, certainement pas le plus simple, de la destruction totale de toute forme et structure de la domination existante, dans une perspective et une pratique révolutionnaire et anti-autoritaire. Nous ne ferons pas de plans immobiliers alternatifs, pour le démantèlement programmé de ce bâtiment-ci plutôt que de celui-là, telle une entreprise de démolition, mais anarchiste. On créerait ainsi un autre spectacle, opposé à celui de nombreux alternatifs qui luttent contre la gentrification. Nous ne croyons pas en la dé-construction, nous croyons en la destruction.