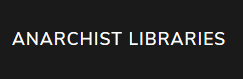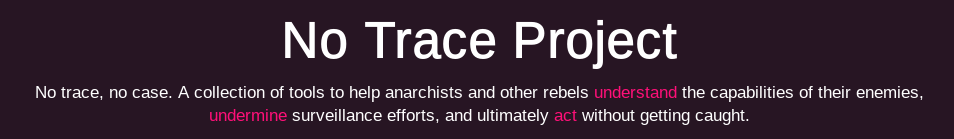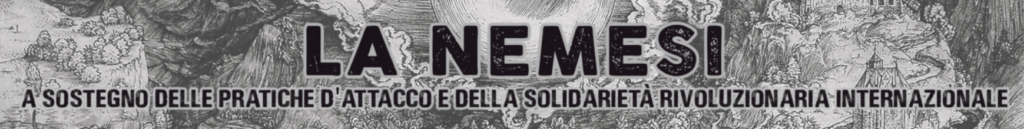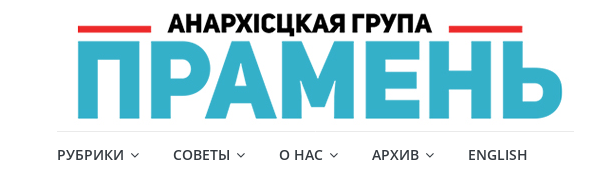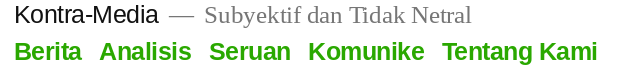Canenero n. 37 / 1er novembre 1996
« Le fait est que l’État ne serait pas si maléfique si celui qui le désire pouvait l’ignorer et vivre sa vie à sa façon, à côté de ceux avec qu’il s’entend bien. Mais il a envahi toutes les fonctions de la vie sociale, domine tous les actes de notre vie et nous empêche même de nous défendre, lorsque nous sommes attaqués.
Il faut le subir ou l’abattre. »
Errico Malatesta
 Si nous n’étions pas profondément insatisfaits par ce monde, nous n’écririons pas dans ce journal, et vous ne liriez pas cet article. Cela est donc inutile d’employer davantage de mots pour réaffirmer notre aversion envers le pouvoir et ses expressions. Ce qui, en revanche, ne nous paraît pas inutile est d’essayer de comprendre si une révolte qui ne se pose pas ouvertement, résolument contre l’État et le pouvoir est-elle possible.
Si nous n’étions pas profondément insatisfaits par ce monde, nous n’écririons pas dans ce journal, et vous ne liriez pas cet article. Cela est donc inutile d’employer davantage de mots pour réaffirmer notre aversion envers le pouvoir et ses expressions. Ce qui, en revanche, ne nous paraît pas inutile est d’essayer de comprendre si une révolte qui ne se pose pas ouvertement, résolument contre l’État et le pouvoir est-elle possible.
Cette question ne doit pas paraître bizarre. Il y a en effet des personnes qui ne voient, dans la lutte contre l’État, rien d’autre qu’une confirmation ultérieure de combien il a pu entrer à l’intérieur de nous-mêmes, au point de déterminer, même en négatif, nos actions. Avec son encombrante présence, l’État nous distrairait de celui qui devrait être notre véritable objectif : vivre notre vie à notre façon. Si on pense à abattre l’État, à l’entraver, à le combattre, on n’a pas le temps de réfléchir à ce que nous voulons faire. Au lieu d’essayer de réaliser nos désirs et nos rêves ici et maintenant, nous suivons l’État partout, devenons son ombre et repoussons à l’infini la concrétisation de nos projets. A force d’être antagonistes, d’être contre, on finit par ne plus être protagonistes, ne plus être pour quelque chose. Du coup, si on veut être soi-même, il faut arrêter de s’opposer à l’État et commencer à le considérer non plus avec hostilité, mais avec indifférence. Plutôt que s’affairer à détruire son monde, le monde de l’autorité, il vaut mieux construire le notre, celui de la liberté. Il faut arrêter de penser à l’ennemi, à ce qu’il fait, où il se trouve, comment faire pour le frapper, afin de se consacrer à nous-mêmes, à notre « vécu quotidien », à nos rapports, à nos espaces qu’il faut élargir et améliorer de plus en plus. Sinon, on ne fera jamais rien d’autre que de suivre les échéances du pouvoir.
Aujourd’hui, de tels arguments foisonnent au sein du mouvement anarchiste, à la recherche perpétuelle de justifications déguisées en analyses théoriques, pour excuser sa propre inaction totale. Il y en a qui ne veulent rien faire parce que sceptiques, d’autres parce qu’ils ne veulent rien imposer à autrui, d’autres qui pensent que le pouvoir est trop fort pour eux et enfin d’autres qui ne veulent pas en suivre les rythmes et les temporalités ; tout prétexte est bon. Mais est ce que ces anarchistes ont-ils un rêve capable de leur enflammer le cœur ?
Pour débarrasser le camp de ces excuses minables, ce n’est pas inutile de rappeler deux-trois choses. Il n’y a pas deux mondes, le leur et le nôtre, et même si ces deux mondes existaient, ce qui serait absurde, comment pourraient-ils cohabiter ? Il y a un seul monde, le monde de l’autorité et de l’argent, de l’exploitation et de l’obéissance : le monde dans lequel nous sommes obligés de vivre. Il n’est pas possible d’en sortir.Voilà pourquoi on ne peut pas se permettre l’indifférence, voilà pourquoi on n’arrive pas à l’ignorer. Si on s’oppose à l’État, si on est toujours prêt à saisir l’occasion pour l’attaquer, cela n’est pas parce qu’on en est indirectement façonnés, cela n’est pas parce qu’on a sacrifié nos désirs sur l’autel de la révolution, mais parce que nos désirs seront irréalisables aussi longtemps que l’État existera, aussi longtemps qu’existera un quelconque pouvoir. La révolution ne nous détourne pas de nos désirs, mais au contraire elle est la seule possibilité qui donne les conditions pour leur réalisation. Nous voulons subvertir ce monde, le plus tôt possible, ici et maintenant, car c’est ici et maintenant qu’il y a casernes, tribunaux, banques, béton, supermarchés, taules. Ici et maintenant, il n’y a qu’exploitation. Tandis que la liberté, ce qu’on entend par liberté, elle n’existe pas du tout.
Ceci ne veut pas dire qu’on doit négliger la création d’espaces à nous où expérimenter les rapports que nous préférons. Il signifie simplement que ces espaces, ces relations, ne correspondent pas à la liberté absolue que nous voulons, pour nous ainsi que pour tout le monde. Ce sont un pas, un premier pas, mais pas le dernier, encore moins le pas définitif. Une liberté qui se termine sur le seuil de notre squat, de notre commune « libre », ne nous suffit pas, ne nous satisfait pas. Une telle liberté est illusoire car elle ne nous rendrait libres que de rester chez nous, de ne pas sortir des limites qu’on s’est données. Si on ne considère pas la nécessité d’attaquer l’État (et sur ce concept d’ « attaque » il y a aurait beaucoup à dire), au fond nous ne faisons que lui permettre de faire davantage et à jamais ce qui lui plaît, nous limitant à survivre dans la petite « île heureuse » qu’on se sera construite. Rester à distance de l’État signifie garder sa vie, l’affronter signifie vivre.
Dans l’indifférence envers l’État se trouve, implicitement, notre capitulation. C’est comme si on admettait que l’État est le plus fort, il est invincible, il est irrésistible, donc autant déposer les armes et penser à cultiver son jardin. Comment appeler cela révolte ? Il nous semble plutôt une attitude toute intérieure, limitée à une sorte de méfiance, d’incompatibilité et de désintérêt pour ce qui nous entoure. Mais dans une telle attitude demeure, implicitement, la résignation. Une résignation dédaigneuse, si l’on veut, mais toujours de la résignation.
Tel un boxeur sonné qui se limite à parer les coups, sans même essayer d’abattre l’adversaire, que pourtant il haït. Mais notre adversaire ne nous donne pas de répit. On ne peut pas descendre de ce ring et il continue à nous prendre pour cible. Il faut subir ou abattre l’adversaire : l’esquiver ou lui signifier notre mécontentement ne suffit pas.
Gruppo anarchico insurrezionalista « E. Malatesta »