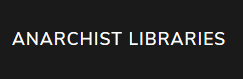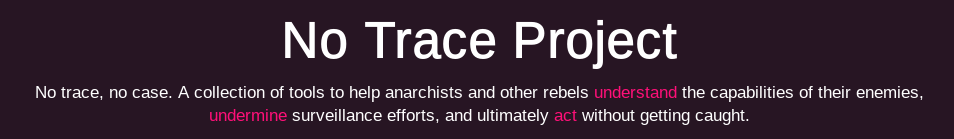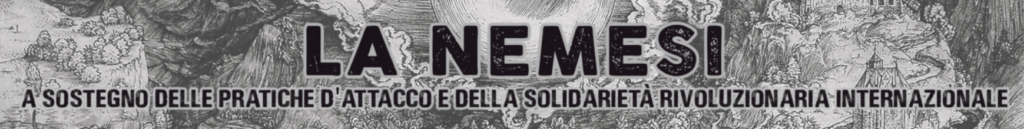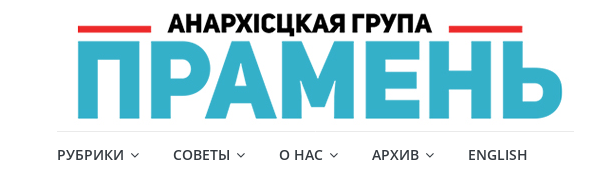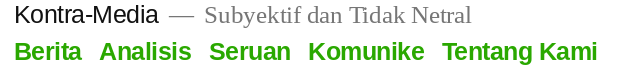NdAtt. Pendant que la juteuse collaboration des assos humanitaires à la gestion de la « crise des migrants » bat son plein, et à quelques jours du procès en appel contre des solidaires intervenus lors de la grève de la faim des sans-papiers hébergés dans un centre Emmaüs, l’été 2015, voilà un texte sur le rôle de la charité dans cette société et ce qui, au contraire, pourrait et devrait être la solidarité.
On ne veut pas d’aumône !
Quelques notes sur la complicité et la solidarité
Des Ruines, revue anarchiste apériodique, n. 1 / hiver 2014
Miettes
Explicite ou implicite, un certain degré de consensus de la part des sujets est nécessaire au pouvoir pour se maintenir, tout autant et même peut-être plus que la force. En effet, cette dernière entre en jeu seulement quand le consensus ne fonctionne plus. Ceux qui détiennent le pouvoir ne pourraient pas s’appuyer uniquement sur les armes pour faire tenir à leur place les dominés. Ils utilisent donc la méthode du bâton et de la carotte. Au lieu de mettre les dominés dos au mur, le pouvoir (politique, économique, moral) les implique dans la gestion de ce monde, par exemple en leur octroyant quelques « droits ». Il donne un petit lopin de jardin à nombre d’exploités, afin que leur priorité soit la sauvegarde de ces bribes. La peur de tomber encore plus bas nous retient donc de renverser la table de ce jeu visiblement truqué.
Le pouvoir cherche donc à mettre des pansements sur les aspects les plus crus de l’exploitation, pour préserver l’image du « meilleur des mondes possibles » et parfois aussi pour se donner bonne conscience. Ces miettes données aux pauvres sont comme de l’huile qui permet à la domination de fonctionner avec le moins de frictions possibles.
Il s’agit avant tout de la charité étatique : l’État-providence. Qu’elles s’appellent RSA, CAF, APL, CMU, chômage, logements sociaux, etc., ces mesures « sociales » ne sont généralement pas perçues comme de l’aumône, mais comme des droits. Comme quelque chose pour lequel il faudrait lutter (pour les défendre et les élargir) et qui sont d’ailleurs le résultat des luttes, revendicatives et réformistes, du passé. Mais ce sont des droits que l’on paye par notre soumission, chaque jour. Par l’acceptation du contexte général de l’exploitation dont « nos » droits sont une partie. Ce sont des miettes qu’on nous distribue pour qu’on reste à notre place, calmes et si possible laborieux. Et en continuant à lutter pour obtenir, sauvegarder ou élargir de tels droits, on lutte pour le maintien de la domination, juste un tantinet accommodée d’un peu de fard. Moins brutale et directe donc, mais aussi plus ambiguë.
Et puis il y a aussi cette cale du pouvoir qu’est l’humanitaire, tout le cirque des associations caritatives, ces vampires qui vivent de la douleur et de la misère des autres. Elles peuvent être religieuses, comme le Secours catholique, l’Ordre de Malte (également catho, avec un budget de quelques 40 millions d’euros en 2008), l’Armée du salut (évangélique), la Cimade (évangélique, elle s’occupe surtout des sans-papiers) ou le Secours islamique. Il y en a d’encore plus institutionnelles, comme France terre d’asile, le Secours populaire français, le SAMU Social (ils maraudent la nuit à la recherche de SDF – et parfois ça finit en cellule de dégrisement…) ou la pieuvre de la Croix Rouge, qui est partout là où coulent sang et larmes. Il y en a des plus rafistolées, comme les Petits frères des pauvres, les Restos du Cœur ou de nombreuses autres petites associations, souvent de gauche. Et le marché de la bienfaisance, avec des dons ou bien des subventions de l’État, rapporte pas mal de fric à toutes ces assos. Citons comme exemple Emmaüs (laïque, mais fondé par un abbé catho – et politicien à l’occasion) : Emmaüs Habitat, sa filiale qui gère des HLM, possède un parc de 13.000 logements en Île de France !
Il y en a parmi ces vautours qui sont ostensiblement au service du pouvoir. L’Armée du Salut gère des prisons pour étrangers clandestins en Australie, tandis qu’ici c’est la spécialité de la Cimade de faire passer la pilule de l’enferment et de la déportation. La Croix Rouge, elle aussi (bien sûr !) participe activement à l’expulsion des sans-papiers. Elle est présente par exemple dans la ZAPI 3, une prison pour sans-papiers à l’aéroport de Roissy. D’ailleurs, sa position de prétendue neutralité la met toujours du côté du plus fort, comme le rappelle son silence face aux camps de concentration nazis, entre autres. Aujourd’hui encore, elle sert de couverture pour toutes les violences policières dans les camps pour sans-papiers (jusqu’au viol, comme ça a été le cas dans le CRA de Milan en 2010). La Croix Rouge est également une habituée des taules : depuis 1999, elle a une convention de partenariat avec l’Administration Pénitentiaire pour l’amélioration des conditions de vie en détention (c’est pas une blague !) et la réinsertion des ex-taulards. Eux, c’est bien la carotte pour nous maintenir soumis, sachant bien que nul flic ne pourra jamais mater une révolte généralisée, ou même la rébellion d’individus bien déterminés.
L’aide de l’État ou des clowns du cirque de la bonne conscience bourgeoise est parfois indispensable afin de donner une solution d’appoint à des situations précises. Évidemment, c’est en général mieux de dormir dans un foyer qu’à la rue. Et RSA, CAF, Assedics, etc. sont très souvent nécessaires pour survivre. N’oublions pas, pourtant, qu’ils sont des éléments fondamentaux de la justification idéologique de ce même système qui nous exploite et parfois nous broie.
En effet, le rôle fondamental de toutes ces assos humanitaires et encore plus de l’État-providence est la sournoise justification de ce monde de domination. Les droits dans lesquels les exploités se vautrent, et dont souvent ils se contentent comme si c’était tout ce dont on pouvait rêver, tout comme la charité des « humanitaires », sont des cache-misères et des prothèses sur lesquelles le pouvoir peut compter. Derrière cette aide (supposée) il y a la spéculation sur des situations de besoin. Tout droit a comme revers de médaille un devoir, et accepter ses « droits » revient à accepter le système démocratique, la subdivision de la société entre puissants et esclaves, juste un petit peu masquée. Le « merci » qu’on adresse aux bonnes âmes caritatives est une caution fondamentale de cet ordre social d’exploitation. Dans le chantage des droits et de la charité, on troque une soupe, des soins, un revenu ou un toit contre la renonciation à critiquer ouvertement, à penser et agir en tant qu’individus indépendants. L’État et les humanitaires cherchent à apprivoiser, à acheter les derniers parmi les pauvres, à les calmer avec leurs petits bonbons, pour éviter que la guerre sociale n’apparaisse au grand jour. Travailleurs sociaux et bénévoles humanitaires sont bel et bien des missionnaires de la pacification sociale. La pacification entre puissants et exploités, un sale mensonge qui voudrait couvrir l’exploitation elle-même.
Parmi les fonctionnaires et les bénévoles « de base » de ces assos, il y en a sans doute qui sont sincèrement convaincus de faire du bien. Mais ne pas voir le rôle de soutien du système qu’est celui du secteur social et des assos caritatives, c’est fermer volontairement ses yeux. C’est de l’hypocrisie. Le fait que quelqu’un soit en mesure de « faire du bien » et quelqu’un d’autre dans la nécessité de l’accepter, pose la question d’un paternalisme qui voudrait cacher mais en fait perpétue et justifie l’exploitation et la division entre dominants (et leurs larbins) et dominés. Nous ne voulons pas « faire du bien », mais renverser ce monde mortifère, faire en sorte qu’il n’y ait plus besoin d’accepter la charité.
Il ne s’agit pas ici de cracher dans la soupe que l’on mange – et d’ailleurs il n’y a parfois que ça à manger. Mais sachons que rien dans ce monde n’est donné gratuitement, qu’aucun de nos choix ou de nos actions n’est neutre. Que nos droits sont des chaînes autant que nos devoirs et que les deux vont forcément ensemble. Cette société a d’un côté des instances « nourricières » et « protectrices » envers ses membres, de l’autre des instances répressives et de contrôle. Ces typologies sont mélangées de façon inextricable (et c’est justement là son paternalisme).
Le devoir le plus important, celui sur lequel tout pouvoir se base, celui qu’on nous inculque depuis le plus jeune âge, est aussi celui qu’on met le moins souvent en doute. Celui qu’on remarque le moins car il passe pour « normal ». Il s’agit de l’attitude d’obéissance vis-à-vis de l’autorité. Une obéissance qui ne saurait être seulement le fruit de la coercition. Elle se base sur tout un panel de raisons, des plus idéologiques aux plus concrètes et rationnelles, tels les bénéfices (matériels, symboliques, relationnels, psychologiques) que la société (et toute autorité en fait) nous accorde en contrepartie de notre obéissance. Des bénéfices qui peuvent être minimes, mais « mieux que rien », « mieux que la galère », « mieux que la taule », « mieux que crever ». Certes, mais la vie est autre chose. La vie devrait et pourrait être autre chose.
Illusions
Dans une perspective de changement radical de nos vies, chose qui passe nécessairement par la destruction de ce monde, ce serait une erreur capitale de se borner à la défense de « nos droits ». Stratégiquement, toute « défense », toute « résistance » part déjà perdante, car elle joue dans un champ défini par l’ennemi (dans ses buts, ses temporalités, ses spatialités, etc.). Toutefois, ce qui est plus important est l’aspect éthique du problème. On n’a rien à défendre, dans cette société, rien qui soit à nous, comme si les chaînes plus ou moins longues qui nous entravent étaient « à nous »… Ce que l’on cherche est complètement différent, on ne le trouvera que dans les décombres de ce monde, on ne peut commencer à le vivre que quand nos idées et critiques, nos tensions et désirs prennent corps, par moments, dans la forme de l’attaque. Assurément pas dans la défense de quoi que ce soit de ce qui nous a été octroyé : droits, services publiques, travail, revenu, territoires, quartiers, etc.
Il pourrait sembler qu’en disant cela on ne fait que contourner le problème de la survie quotidienne avec des pirouettes rhétoriques ou de l’idéologie creuse. En effet, il n’y a pas de bonne solution lorsqu’il s’agit de survivre de façon digne dans ce monde. Chacun de nous doit trouver son propre chemin, selon les compromis qu’il est prêt à faire. Car on doit forcément faire des compromis. Mais admettons-le, arrêtons de considérer nos « droits » comme une conquête, un « acquis social », et sachons que dans cette société nous ne pouvons pas parler de liberté, mais seulement des différents compromis à propos de la longueur de la laisse.
Dans le louche spectacle samaritain de l’État-providence, comme contrepartie à l’hypocrisie des riches qui se lavent la conscience, il y a l’humiliation et l’infantilisation des pauvres qui sont dépendants de la charité. Les exclus, les personnes les plus démunies, sont considérées (et parfois amenées à se considérer elles-mêmes) comme des idiots dont quelqu’un doit s’occuper, car elles ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes.
La dépendance face à une aide extérieure habitue les pauvres à la servilité et à ne pas avoir confiance en eux-mêmes, en nos propres capacités, en notre propre force, à attendre que les solutions à nos problèmes arrivent d’ailleurs que de nous-mêmes. On veut nous habituer à demander gentiment de l’aide à nos ennemis : l’État et les puissants. Un des effets de la charité, étatique ou humanitaire, est donc celui d’abrutir, littéralement, ceux auxquels elle s’adresse. Elle engendre en eux une acceptation de leur impuissance et de leur dépendance. Une renonciation à la dignité de se voir comme des individus libres qui ont la possibilité de prendre leur propre vie en main. Telle une drogue, la charité nous rend dépendants, résignés et incapables.
Il nous faudrait donc quelqu’un de « gentil », quelque « âme pieuse », quelque illuminé de gauche, pour veiller sur nous, et tiens ! Il s’agit de ceux-là mêmes qui, par ailleurs, profitent du système qui crée la pauvreté. Ils s’endorment tranquilles, eux, dans leurs belles maisons, satisfaits de leur bonté qui les amène à se préoccuper des moins heureux. De nous, nous qu’ils exploitent à longueur de vie ! Avec leurs aumônes, ces faux-culs croient se gagner le paradis ou cultivent leur gauchisme. Mais avec cette exploitation de la misère, ils cherchent surtout une reconnaissance concrète. Celle-ci peut assurer paix sociale et consensus (parfois sous forme de votes), qui profitent bien à ceux qui sont en position privilégiée.
La solution pourrait sembler être une quelconque forme d’autogestion de la société de la part des exploités. Ce n’est qu’une chimère. Il n’y a rien à autogérer dans ce monde, si ce n’est les moyens de le détruire, c’est-à-dire notre propre force de combat. Certes, l’autogestion de la survie pourrait bien faire oublier un moment la sensation d’impuissance et de dépendance. Il ne s’agit pourtant de rien d’autre que d’apporter des solutions (« ses » solutions, des « bonnes » solutions) aux problèmes occasionnés par un système d’autorité et d’exploitation, sans pourtant vraiment remettre celui-ci en question. Il s’agit là encore d’un pansement sur les plaies incurables de ce monde, un pansement aux couleurs de l’extrême-gauche ou même d’un certain « anarchisme ». Ce qui est parfois présenté par ses ténors comme le germe d’une nouvelle société, s’avère n’être que l’énième béquille de cette société-ci. La seule chose à faire pour changer la vie pour de vrai, notre vie, ici et maintenant, est d’abattre toute exploitation, toute autorité.
Certaines soi-disant « luttes » qui visent des buts limités ne sont parfois rien d’autre que des démarches paternalistes et caritatives, politiques, elles aussi. Et cela peut se faire avec de la paperasse ou avec des piquets dans la rue, mais ce qui reste inchangé est leur but : défendre un droit, qu’il soit statué par la loi ou bien par une quelconque idée citoyenniste d’« équité ». Combien de permanences – mais auto-organisées ! – pour expliquer leurs droits aux sans-papiers, aux précaires, aux sans-logis, etc. et les aider dans leurs démarches administratives. Combien de slogans « Des papiers pour tous !», qui lancent un pari au rabais, mal recouvert du cache-misère du « … ou plus de papiers du tout !», ajouté les dents serrées. Combien de « solidarité » avec des prisonniers qui se cantonne à des cartes postales, à l’envoi d’argent ou, dans le meilleurs des cas, à des rassemblements devant des murs. Combien d’assemblées avec les « vrai gens », comme on peut l’entendre, sur la base de leurs supposés « besoins réels ». Comme si les « besoins » des « gens » c’était encore une fois des miettes à obtenir à l’aide de quelques âmes pieuses et conscientes – des révolutionnaires sans parti ni chef, cette fois-ci ! Des « révolutionnaires » qui, tout en critiquant en théorie l’existant dans sa totalité, s’affairent pour que les « victimes » momentanément à la mode puissent y trouver leur place. Il n’est pas rare que l’on feigne de ne pas voir les compromis faits pour « être avec les gens », comme on dit. Ce qu’on dit combattre et qu’on refuse (ou qu’on dit refuser) pour nous-mêmes, comme le travail, la famille, les traditions communautaires ou religieuses, n’est plus si mauvais si on le demande ou qu’on le défend pour des « gens normaux », et on est prêts à fermer les yeux sur beaucoup trop de choses. Ça sent le paternalisme « à l’envers » qui prend la forme de la condescendance des « révolutionnaires conscients » envers les « gens normaux » qu’il faudrait éclairer, mais en douceur, sans les choquer avec des idées qu’ils sont censés ne pas comprendre…
On est mus par l’empathie humaine? Très bien, mais alors qu’on arrête de parler de révolution (et de critiquer les humanitaires – eux sont plus cohérents). Ou bien n’y aurait-il pas parfois des calculs politiques derrière, du genre « donnant–donnant », pour obtenir une « autorité morale », une « reconnaissance » parmi l’énième catégorie d’exploités ? Un levier politique, obtenu en jouant, comme tout bon politicien, sur la peau des autres ?
Cela n’exclut pas l’entraide entre exploités et la solidarité entre révoltés. Mais l’entraide, pour ne pas glisser dans le paternalisme, devrait être un rapport de réciprocité, sans la hiérarchie implicite de la dualité besogneux/bons samaritains (ou « sujet révolutionnaire du moment »/soutiens politiques). L’entraide devrait être une façon de trouver ensemble des solutions à des problèmes communs liés à la survie dans ce monde (sans se cacher les limites d’un telle démarche).
La solidarité, quant à elle, pourrait être une reconnaissance mutuelle parmi celles et ceux qui ont décidé de ne plus baisser la tête, qui rêvent d’autre chose et parcourent des routes, chacun à sa manière, vers un but partagé : le renversement de l’existant. Pas une forme de défense, mais bien une base de départ plus large pour qui est déjà passé à l’offensive. Une arme qui nous rend plus forts parce que conscients que d’autres ont choisi, comme nous, de riposter.
Pauvres, nous n’avons pas besoin de la charité des riches et de l’État, ni de chercher des guides parmi nos rangs. On peut très bien se débrouiller seuls, avant tout en balayant les puissants et leur monde. N’oublions pas que le dompteur donne de la nourriture au fauve en lui faisant croire que sans lui il mourrait de faim. Pourtant le fauve pourrait bien trouver sa liberté en commençant par dévorer le dompteur. En ces temps sombres, on sent déjà souffler la brise qui pourrait devenir tempête. Et là, chacun sera obligé de choisir son camp sans ambiguïté.