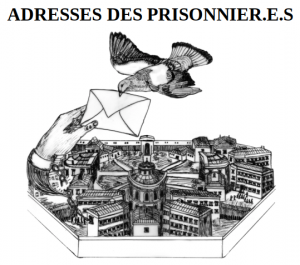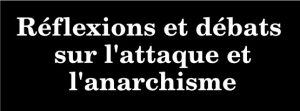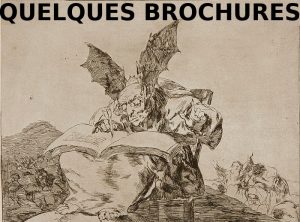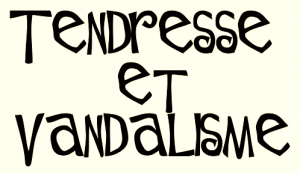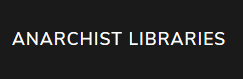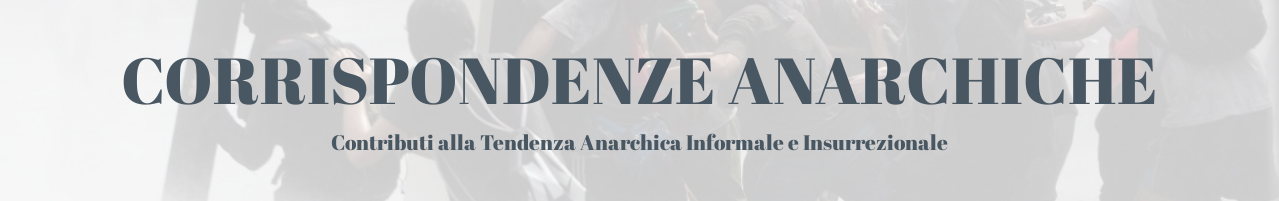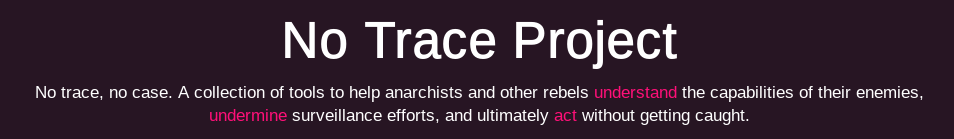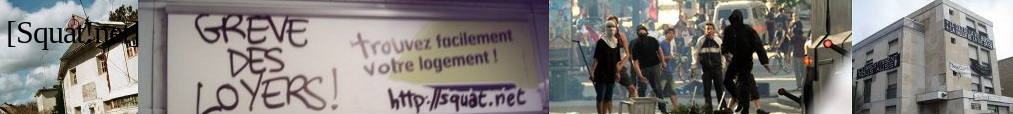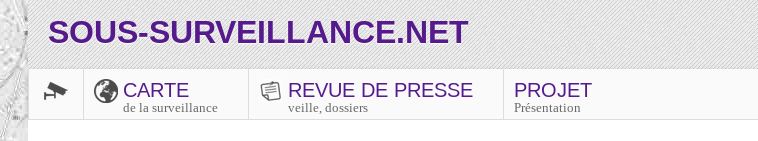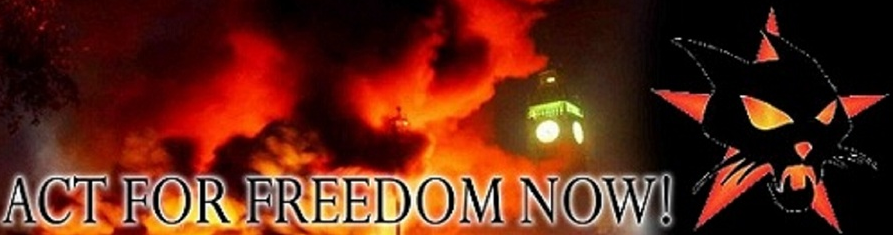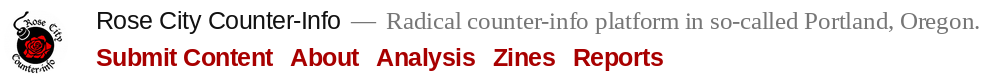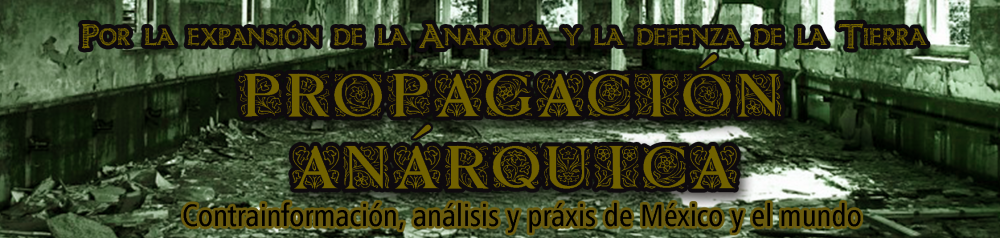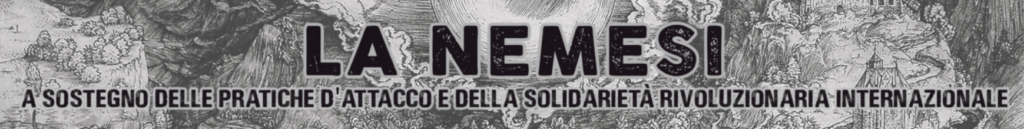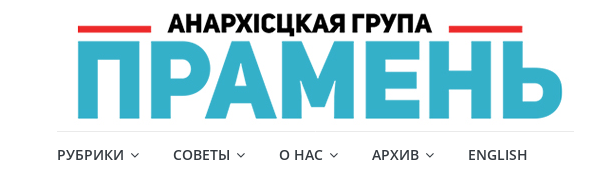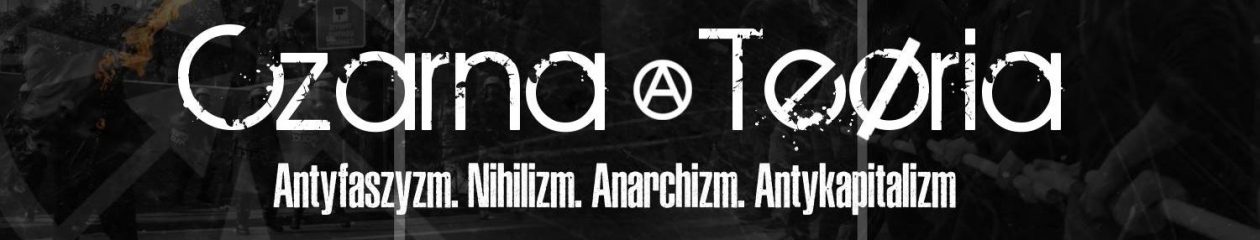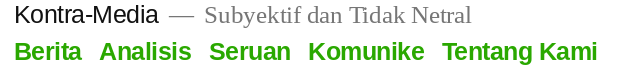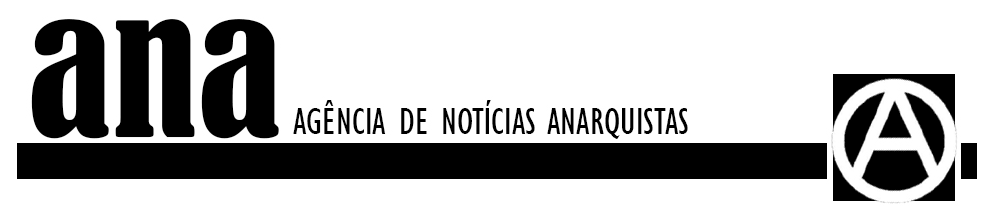Contra Info / mardi 24 décembre 2024
Considérations sur la liberté. Un texte du compagnon anarchiste Francisco Solar
 La liberté est sans doute un principe fondamental dans les différents discours et tendances anarchistes. Elle constitue un axe d’articulation à partir duquel s’élaborent des propositions, des projets et des pratiques, en partant du principe que l’existence d’un pouvoir centralisé détermine les différentes oppressions qui affectent les communautés et les individus. C’est l’État, ou toute autre expression du pouvoir, qui en fin de compte engendre et renforce ce système d’exploitation et toutes ses conséquences. Les tentacules, les effets et les manifestations de celui-ci – de plus en plus imperceptibles – vont dans de multiples directions et englobent pratiquement tous les aspects de la vie des gens.
La liberté est sans doute un principe fondamental dans les différents discours et tendances anarchistes. Elle constitue un axe d’articulation à partir duquel s’élaborent des propositions, des projets et des pratiques, en partant du principe que l’existence d’un pouvoir centralisé détermine les différentes oppressions qui affectent les communautés et les individus. C’est l’État, ou toute autre expression du pouvoir, qui en fin de compte engendre et renforce ce système d’exploitation et toutes ses conséquences. Les tentacules, les effets et les manifestations de celui-ci – de plus en plus imperceptibles – vont dans de multiples directions et englobent pratiquement tous les aspects de la vie des gens.
En entendant la liberté comme un processus permanent d’appropriation graduelle de nos vies, d’où l’on essaie d’éliminer toutes les vestiges de l’autorité qui prétend nous contraindre, ainsi que ceux qui se trouvent dans nos propres comportements, la liberté ne constitue pas un point d’arrivée auquel nous devrions aspirer. Il est donc très probable que la liberté comme entité établie, comme point culminant d’un chemin, n’existe pas, peut-être qu’elle n’est qu’une rêverie, c’est pourquoi je crois que notre regard ne doit pas être fixé là-dessus, mais sur le processus de lutte contenu dans ce concept. Comme l’a bien dit Don Quichotte : « le chemin est plus importante que l’auberge ». Ce sont la construction de relations qui essayent d’être libres et la destruction de toute expression d’autorité qui devraient être au centre de nos préoccupations et de notre travail, car c’est par la pratique quotidienne et son approfondissement que nous arrachons des moments de liberté. Cela ne signifie pas que la décision de s’engager dans ce chemin fait de nous des êtres libres ou que nous avons atteint la liberté tant désirée, cela représente seulement une option de lutte dans la recherche de se débarrasser de l’autorité. Par conséquent, nous ne sommes pas libres et nous ne savons pas si un jour nous le serons, chose à laquelle nous ne prêtons certainement pas d’attention.
À ce point, il est pertinent de faire rapidement référence à la distinction que l’irrévérencieux Albert Libertad a fait dans son article « La liberté », de 1907, entre les termes « anarchiste » et « libertaire ». Le premier « ne fait pas de la liberté la causalité mais plutôt la finalité de l’évolution de son individu. Il ne dit pas, même lorsqu’il s’agit du moindre de ses gestes : « Je suis libre », mais : « Je veux être libre » ». Alors que le libertaire entend la liberté comme « le commencement et la fin de toutes choses […] se déclarer libre de ses mouvements alors que le déterminisme héréditaire, atavique et ambiant vous fait esclave ».
Pour l’anarchiste, il est claire qu’il est indispensable de lutter pour la liberté, ce qui constitue un affrontement quotidien avec l’autorité. Au contraire, le/la libertaire se sent et se croit libre et pense qu’elle/il doit défendre cette liberté conquise. Il/elle ne voit pas ou ne veut pas voir les multiples oppressions auxquelles elle/il est soumis.e, dérivées en grande partie du Pouvoir.
Cette description qu’Albert Libertad fait des libertaires, nous pouvons la voir aujourd’hui, par exemple, dans les espaces qui se définissent eux-mêmes comme « safes », dans cette idée de construire des « bulles de liberté » qui seraient libres de toute forme d’autorité. Ces espaces, selon leurs défenseur.euses, seraient exempts des multiples nocivités de l’« extérieur », en concentrant une grande partie de leurs efforts à éviter – prétendument et naïvement – l’intrusion de « comportements néfastes » dans leurs dynamiques internes.
Concevoir la liberté de telle manière, en plus d’être une illusion, implique un risque pour toute position conflictuelle, dans la mesure où cela pense et propose l’existence d’expériences libres dans le cadre de la domination la plus complète et la plus absolue.
LES RISQUES D’UNE ILLUSION
Le Pouvoir, sous ses différentes formes, est présent dans pratiquement tous nos comportements, de sorte que, aujourd’hui, nous le reproduisons, consciemment ou inconsciemment ; cela est indéniable. Pour celles/ceux qui font le pari d’une vie sans entraves, cela représente évidemment une contradiction que nous devons avoir claire et toujours présente à l’esprit. Cela implique, entre autres, de nous remettre en question en permanence, ce qui constitue une partie fondamentale de notre lutte contre l’autorité, sur ce chemin interminable que nous faisons, au niveau individuel et collectif. Néanmoins, l’illusion de se penser « libres », étranger.es à l’oppression, s’est installée comme un argument puissant pour justifier des comportements qui sans doute nous affaiblissent et nous privent, de manière plus ou moins importante, de sérieux.
Une pratique qui a caractérisé les anarchistes tout au long de l’histoire est l’engagement inflexible à la parole donnée, ce qui est reconnu et estimé par toutes les tendances révolutionnaires et même par nos ennemis. Cette caractéristique nous a imprimé une éthique particulière : faire ce que l’on dit, essayer par tous les moyens d’être cohérent.es avec nos propositions. N’ayant pas, et étant contraires à, des statuts rigides qui fixent des normes de comportement, la parole [donnée] est ce qui nous donne une identité et nous fortifie, qui nous donne de la continuité et de la crédibilité. Pourtant, ce riche héritage est effacé d’un trait de plume, avec l’argument surprenant du « respect de la liberté individuelle ».
Les engagements pris seraient souvent un obstacle au développement de la prétendue liberté individuelle, parce que l’on part du principe que les priorités absolues sont l’intérêt et le désir personnels. Ce qui attire l’attention est que ces engagements ne sont pas le fruit d’une obligation, au contraire, ils sont le résultat de la volonté et de l’initiative personnelles. Par conséquent, cette manière de comprendre la liberté individuelle nous amène à nous demander : quelle solidité peuvent avoir nos projets collectifs ? Quel sérieux peut avoir la parole que nous donnons, si elle est soumise aux changements de notre état d’esprit et de nos émotions ?
« J’ai la liberté de faire ce que je juge utile, y compris, le moment venu, de manquer aux engagements pris ». Tel est l’argument qui se trouve derrière cette conception néfaste de la liberté individuelle, qui n’est rien d’autre que la recherche d’une justification enfantine de l’irresponsabilité. Cela rend non seulement irréalisable toute initiative commune, car laisse s’installer la méfiance, mais jette aussi par dessus bord cette cohérence qui est le résultat du travail historique des compas qui nous ont précédé.es et qui est estimée comme faisant partie de notre arsenal théorique-pratique, qui nous distingue des autres tendances révolutionnaires.
De la même manière que certains espaces se pensent sûrs et étrangers à toute forme d’autoritarisme et d’exploitation, l’individu qui se croit libre considère qu’il a conquis quelque chose et qu’il doit en prendre soin, il voit donc dans la lutte quelque chose de non nécessaire, qui manque de sens. L’inaction va alors de pair avec cette façon de comprendre la liberté, encourageant ainsi une coexistence pacifique avec l’oppression. Ainsi, l’affrontement contre le pouvoir est nié et même critiqué, parce qu’il n’aurait pas de raison d’être ; en plus, il est souvent vu comme une menace qui peut nuire à la liberté acquise.
Un autre risque de cette illusion libertaire concerne l’adoption de comportements qui se trouvent à l’opposé des nôtres. Avec l’excuse de la « liberté individuelle », à des nombreuses reprises on a fait des choix qui, historiquement, ont été contraires aux pratiques anarchistes. Je pense aux « compas » qui ont décidé d’aller voter pour la social-démocratie, face à la crainte d’une montée du fascisme, ou aussi à ceux/celles qui, se voyant frappé.es par la répression, ont collaboré avec la police et dénoncé des compas.
L’utilisation de cet argument, dans une manière néfaste, intéressée et opportuniste de comprendre la liberté, est arrivée jusqu’à ces extrêmes.
LA LIBERTÉ COMME MOTEUR DE L’AFFRONTEMENT
Albert Libertad a raison de souligner que « [l]’homme n’est pas libre de faire ou de ne pas faire, de par sa seule volonté. Il apprend à faire ou à ne pas faire quand il a exercé son jugement, éclairé son ignorance ou détruit les obstacles qui le gênaient ».
En partant de cette base, la liberté n’est pas quelque chose d’acquis, mais, comme on l’a dit, un chemin qui se réalise à la fois individuellement et collectivement, dans un processus de remise en question permanente, qui vise à éliminer toute forme d’autorité. Et ce chemin signifie affrontement, il signifie lutte contre toute passivité et inaction. Comprendre que l’on n’est pas libre, que l’on vit sous le poids de plusieurs oppressions, constitue pour un.e anarchiste une invitation à la rébellion, pour briser chacune de ces chaînes. Cela représente aussi un effort pour identifier nos contradictions et essayer de les surmonter, en comprenant que nous sommes déterminé.es par un cadre de domination qu’il est indispensable de détruire. Bien qu’il soit clair que nous sommes soumis.es à de multiples aspects de l’autorité, cela ne nous empêche pas d’essayer d’avoir des relations éloignées de, et contraires à, toute forme de contrainte. La lutte pour éliminer l’autorité de nos relations et comportements est ici et maintenant, tout comme l’affrontement contre le Pouvoir. Et c’est à partir de là que nous optons pour l’informalité pour nous organiser, dans et pour l’affrontement, dans la mesure où la flexibilité et le dynamisme qui constituent l’informalité rendent impossible la prédominance et la coercition.
« Luttons pour être libres », c’est la base de la proposition qui place la liberté comme moteur de la lutte, qui a poussé les anarchistes à se lancer dans le combat avec toutes leurs forces et qui est d’actualité, aujourd’hui plus que jamais.
Pour une constellation d’individualités et de groupes d’affinité orientés vers le combat !
Francisco Solar
Prison La Gonzalina – Rancagua
Décembre 2024