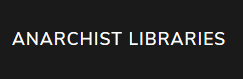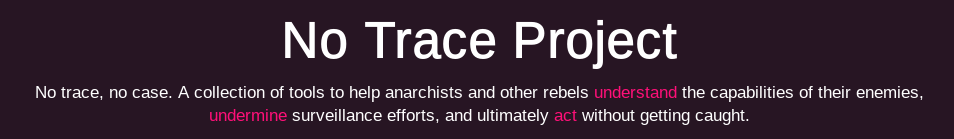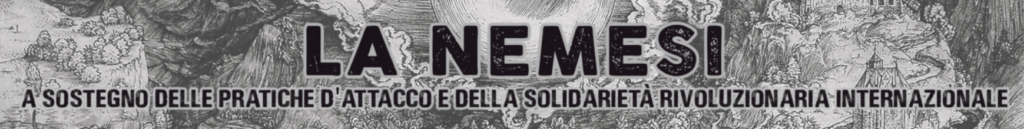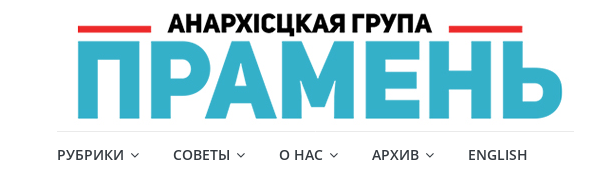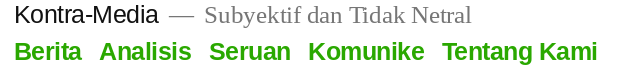IAATA / lundi 11 mars 2024
Bref histoire de la judicarisation de l’ADN.
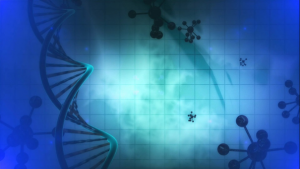 Dans notre imaginaire collectif, nourri par une quantité monstrueuse de fictions policières, l’ADN apparaît comme une preuve infaillible, car scientifique, et donc totalement accablante. À travers une brève histoire de l’ADN, de sa judiciarisation en France, jusqu’à sa plus proche actualité brûlante, ce texte a pour vocation de partager des contres-récits, de montrer ce que l’usage de l’ADN raconte des méthodes répressives de l’État, de sa police et de sa justice mais aussi de partager des ressources nécessaires afin de pouvoir, à des moments, tenter de contrer l’alliance des techniques scientifiques de la génétique et celles des méthodes policières.
Dans notre imaginaire collectif, nourri par une quantité monstrueuse de fictions policières, l’ADN apparaît comme une preuve infaillible, car scientifique, et donc totalement accablante. À travers une brève histoire de l’ADN, de sa judiciarisation en France, jusqu’à sa plus proche actualité brûlante, ce texte a pour vocation de partager des contres-récits, de montrer ce que l’usage de l’ADN raconte des méthodes répressives de l’État, de sa police et de sa justice mais aussi de partager des ressources nécessaires afin de pouvoir, à des moments, tenter de contrer l’alliance des techniques scientifiques de la génétique et celles des méthodes policières.
Nous avons écris ce texte en réaction à la condamnation d’une camarade de lutte le 15 février dernier à Toulouse, accusée d’avoir incendiée deux véhicules appartenant à NGE (l’acteur principal du projet autoroutier tarnais de l’A69) et dont la seule preuve à charge s’avère être une trace ADN. [1] Nous lui rappelons tout notre soutien.
Qu’est-ce que l’ADN ?
Pour le dire rapidement, l’ADN (pour Acide DésoxyriboNucléique) correspond au support de notre patrimoine génétique. Elle contient en elle toutes les informations génétiques, appelées génomes. Ces informations semblent êtres uniques à chaque individu, à l’exception du cas de vrais jumeaux.
L’ADN est présente dans toutes les cellules des organismes vivants, des plantes aux hamsters, mais notre regard se porte ici uniquement sur celui des êtres humains.
L’ADN se découpe en deux types, le type nucléaire et le type mitochondrial.
Le premier type est celui qu’on retrouve dans le noyau des cellules. Il serait unique pour chaque individu. On le trouve dans les cellules vivantes comme le sang, le sperme, la salive. Détaché du corps, il se dégrade plutôt rapidement. L’ADN nucléaire transmet plus d’information car les cellules sont encore vivantes, et qu’elles ont encore leur noyau. On dit alors qu’il est le type le plus incriminant. Le type nucléaire est en réalité rarement exploitable par la police car les cellules meurent vites, laissant l’accès qu’à un ADN dit mitochondrial.
Le second type a une durée de conservation plus avancée. Il se trouve dans les mitochondries, qui sont des structures intracellulaires. On en trouve dans les cellules vivantes, comme mortes, comme des bouts de peau et des cheveux sans bulbes. L’ADN mitochondrial n’est pas unique à un individu, mais se partage à travers les personnes issues de la même lignée maternelle. Des cas existent où des personnes n’appartenant pas à la même affiliation familiale partagent le même profil d’ADN mitochondrial.
C’est en 1869 que le premier ADN est identifié puis isolé par un biologiste suisse, à partir d’un noyau de globule blanc. Puis ce sera dans les années 1950 que le fonctionnement de la structure de l’ADN sera pleinement saisie par des chercheurs nord-américains et britanniques.
Et le profil génétique ?
Le profil génétique est le résultat d’une analyse du nombre de répétitions de plusieurs régions chromosomiques distinctes, prélevé à partir d’une extrait de ses tissus biologiques (salive, sang). « L’empreinte génétique repose sur le fait suivant : bien que deux humains aient une large majorité de leur patrimoine génétique identique, un certain ensemble de séquences dans leur ADN reste spécifique à chaque individu (en raison du polymorphisme). Ce sont ces séquences spécifiques d’un individu que l’analyse d’empreinte génétique permet de comparer. Si un échantillon de cellules présente la même empreinte génétique qu’un individu, on peut soutenir que ces cellules proviennent de cet individu, ou de son éventuel jumeau ». Le profil génétique est utilisé à des fins policières, mais est aussi utilisé lors de la réalisation de dons d’organe, de tests de parentalité ou encore lorsqu’il s’agit d’étudier des animaux.
Petite histoire de la judiciarisation de l’ADN
L’emploi de l’ADN à des fins d’identifications est rendue possible depuis les découvertes scientifiques d’un universitaire britannique en 1985. Ses travaux permettent des « potentialités d’identification d’individus grâce à des marqueurs contenus dans certaines zones non codantes de leur ADN ». Ces identifications se font alors à partir de traces biologiques visibles, comme du sang ou des traces de spermes. En 1997, de nouvelles recherches mettent en évidence la possibilité de traquer de l’ADN à partir de traces invisibles, laissées sur des surfaces touchées par une main, à l’instar des empreintes digitales. La promesse de cette trouvaille, ainsi que son faible coût, font que la police anglaise systématise rapidement l’usage des techniques génétiques pour résoudre des enquêtes criminelles. Dès lors, nous pouvons parler de génétique forensique, comprise alors comme un branche de la science forensique. [2] La génétique forensique utilise la variation génétique existante chez les individus pour en dégager des analyses lors d’enquêtes et d’investigation. Elle renvoie à l’idée d’une preuve forcément inculpant, car gage de précision technique.
En France, suite à l’émotion suscitée par l’affaire Guy Georges (accusé de nombreux viols, ainsi que de meurtres en série, et dont l’enquête scientifique de comparaison d’ADN est alors inédite en France) le gouvernement, mené alors par le socialiste Lionel Jospin, met en place en juin 1998 le prélèvement génétique pour les auteurs de crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de moins de 15 ans.
Les empreintes génétiques sont alors regroupées au sein d’un fichier créé pour l’occasion, le FNAEG (Fichier national automatisé des empreintes génétiques), sous la tutelle du ministère de l’intérieur et celui de la justice. Encouragé par le conseil de l’Europe et la convention européenne des droits de l’homme, l’usage des empreintes génétiques à des fins « d’investigations » est alors en plein essor en France, là où la pratique était déjà bien ancrée chez le gouvernement britannique depuis 1995.
Cette période marque donc l’avènement d’un nouvel élément important dans les dispositifs de gestion des populations, modernisant ainsi la tradition policière de fichage des populations. [3] Le dernier fichage connu en date étant celui de personnes trans. [4]
Avancé dans un premier temps comme une exception, le fichage génétique s’est très vite élargi à une part toujours plus large de la population.
En 2001, quelques semaines après les attentats sur le sol états-unien, la loi sur la Sécurité Quotidienne (qui est portée par le socialiste Daniel Vaillant) élargie le champ de fichage aux atteintes graves et volontaires à la vie de la personne (crimes contre l’Humanité, homicides volontaires, actes de tortures, proxénétisme…) ou les atteintes aux biens accompagnées de violence. Cela concerne environ 23 000 personnes.
La loi sur la Sécurité Intérieure de mars 2003 permet de passer un autre cap important dans le fichage de masse. Avant la mise en application de cette loi, seul le profil génétique des personnes condamnées était conservé. Le prélèvement s’effectue dorénavant pour des mis en cause, présumés innocents par la justice, et non plus sur des personnes déjà condamnées. Le prélèvement est conservé de 25 à 40 ans. Les crimes et les délits sont presque tous intégrés. Cela correspond donc aux premiers fichages de militants (faucheurs d’OGM, syndicalistes) et autres activistes.
En mars 2004, le gouvernement Raffarin « oblige toute personne condamnée à plus de 10 ans de prison à fournir son ADN. Les prélèvements peuvent être effectués de force ou à l’insu des condamnés » À partir de 2007, les 27 membres de l’Union Européenne ont votés pour un accord de principe de mutualisation des différents fichiers, confirmant la tendance politique de surveillance généralisée des États envers leurs différentes populations. Pour avoir une idée de son contenu, en 2020, le fichier contenait « les données de 4 868 879 de personnes, soit plus de 7 % de la population française (dont 9,5% des plus de 20 ans) et en 2015, 76 % de ces profils concernent des personnes non condamnées. »
Que faire face à la police ?
Refuser de donner son ADN lors d’une garde à vue ou d’une convocation est considéré comme un délit continu. Théoriquement, la personne qui refuse le prélèvement pourrait se voir poursuivie pour chaque refus et serait susceptible d’une condamnation du délit en récidive, et cela indépendamment des raisons pour lesquelles la personne est entendue par la police. En bref, il est tout à fait possible de se faire relaxer ou de sortir de GAV sans poursuites pour les faits qui nous sont initialement reprochés, mais d’avoir une mise en examen pour refus d’ADN. Le refus de se soumettre à un prélèvement ADN est puni au maximum « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
L’un des moyens de prélever l’ADN se fait à l’aide d’un petit bâtonnet et d’un buvard stérile. Le policier, muni de gants et d’un masque, eux aussi stériles, vient frotter les muqueuses à l’intérieur de la bouche de la personne dont il souhaite prélever l’ADN. Il dépose ensuite les cellules recueillies sur le buvard. Ce prélèvement est ensuite analysé par des laboratoires publics ou privés agréés par l’État. [5]
L’ADN est ensuite stocké à Ecully, près de Lyon, ou parfois à Pontoise, près de Paris.
Face à la police, nous conseillons au maximum de refuser le prélèvement ADN. Refuser de se soumettre à la pression policière et à leurs nombreuses techniques de manipulations n’est pas une chose aisée. Il est important d’avoir en tête que dans certains cas, les poursuites pour refus de prélèvement peuvent aboutir sur une relaxe en première instance comme en appel. Penser ce refus comme une pratique de défense collective permet de se donner de la force à des moments compliqués. Dans la logique policière, l’utilisation de l’ADN comme preuve judiciaire ne peut se faire sans un fichage massif des populations.
Les techniques policières sont ce qu’elles sont, il n’est pas rare d’entendre des récits, où malgré un refus énoncé, l’ADN est prit par la force (par exemple en étant immobilisé par les policiers) ou bien par la ruse (en récupérant gobelets ou assiettes utilisées lors de la GAV, mégots de clopes, vêtements, ou plus récemment des masques pour le COVID). Pour le premier cas, il n’est encadré par la loi que si la personne est condamné pour un crime ou un délit puni de 10 d’emprisonnement.
ADN, croyances et défaillances
Loin de la preuve parfaite, l’ADN, en tant que tel, est volatile. Il est facilement transportable de manière volontaire comme totalement accidentelle. Il n’est donc pas impossible de retrouver des traces de son ADN à des endroits où nous n’avons jamais mit les pieds. On parle alors de transfert secondaire, mais aussi de transfert tertiaire. Avoir un contact physique avec quelqu’un suffit à ce que cette dernière puisse servir de vecteur de votre ADN. C’est ce que démontre les travaux de l’avocat pénaliste Patrice Reviron qui, à travers l’exemple de nombreuses affaires françaises comme américaines, démonte totalement l’idée que l’ADN est une preuve totalement irréfutable.
C’est le cas en 2019 lors de nuits bleues en Corse. Un groupe autonomiste fait successivement exploser, à l’aide de bonbonnes de gaz, des villas secondaires appartenant à des résidents du continent. Pour l’une des cibles, les bonbonnes n’explosent pas. Les prélèvements génétiques sur les bouteilles de gaz permet à la police d’identifier une personne au profil féminin : une septuagénaire qui n’est autre que la propriétaire de la villa, et qui n’y a pas foutu les pieds depuis 6 mois. L’hypothèse de Reviron pour ce cas est la suivante : des traces d’ADN de la propriétaire se sont retrouvés sur les bouteilles de gaz par effet de transfert. Les auteurs de la tentative d’explosion, qu’on imagine facilement gantés, ont manipulés des objets sur lequel « Madame G. avait laissé son ADN. Peut-être le guéridon. Du matériel génétique de Madame G. a alors été récolté sur les gants de l’auteur, via un transfert secondaire d’objet à objet. Puis, en manipulant les bonbonnes de gaz, il a cette fois déposé l’ADN de Madame G. sur celles-ci, réalisant un transfert tertiaire. » [6]
En finir avec l’ADN Policier
L’usage policier de l’ADN est à l’image des nombreuses lois sécuritaires qui viennent renforcer l’arsenal répressif de l’État contre ses populations. Les avancées scientifiques, imbriquées dans la répression d’État, nous apparaissent inévitablement comme des auxiliaires nécessaires à la domination capitaliste. Par ailleurs, il n’est pas possible de formuler une critique de l’ADN sans poser une critique plus large du système judiciaire, du rapport à la vérité et à l’objectivé, et qui se fourvoie dans une fausse neutralité. La justice de l’État est une justice de classe, qui répond à des intérêts politiques et économiques. Notre solidarité est notre force.
Sources et ressources autour de l’ADN, de la police, et du fichage :
Blabladn – De l’ADN théorique à son nettoyage pratique : en savoir plus pour éloigner les flics https://infokiosques.net/spip.php?article1836
Du sang, de la chique et du mollard. https://infokiosques.net/spip.php?article720
ADN : Au-Delà du « Non ». Un petit texte sur l’état de la lutte contre le fichage ADN, à partir d’un cas pratique. https://infokiosques.net/spip.php?article641
L’apparence de la certitude, l’ADN comme « preuve » scientifique et judiciaire https://infokiosques.net/spip.php?article719
Comment la police interroge, et comment s’en défendre https://projet-evasions.org/wp-content/uploads/2022/07/220707PDF-fr-web-interro.pdf
ARA69, le 25.02
ARA pour Coordination anti-répression A69. Nous sommes un groupe inter-collectifs luttant contre le projet d’autoroute A69, et qui prend à charge les questions de répression policière et judiciaire lié au mouvement de lutte.
Nous contacter par ici : 69ARA@proton.me
Notes
[5] Liste des laboratoires agréés en 2008 :
- Laboratoire d’hématologie médico-légale, 43 avenue de la République, 33000 Bordeaux
- Laboratoire Toxgen, 11 rue du Commandant Cousteau, 33100 Bordeaux
- Laboratoire de génétique humaine de l’Institut national de la transfusion sanguine, 6 rue Alexandre-Cabanel, 75739 Paris cedex 15
- Laboratoire de génétique moléculaire et d’histocompatibilité – Établissement de transfusion sanguine de Bretagne occidentale, 46 rue Félix le Dantec, BP 62025, 29220 Brest cedex 2
- Laboratoire d’histocompatibilité de l’Etablissement de tranfusion sanguine de Rhône Alpes, EFS Rhône Alpes, site de Lyon, 1 et 3 rue du Vercors, 69342 Lyon
- Laboratoire de biochimie et de biologie moléculaire du Centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain, 20 rue Armogis, 78105 Saint-Germain-en-Laye
- Laboratoire d’empreintes génétiques Biomnis, BP 7322, 19 avenue Tony Garnier, 69357 Lyon cedex 07
- Laboratoire d’identification génétique Codgene.
- Unité de Illkirch, rue Geiler de Kaysersberg, 67400 Illkirch.
- Unité de Marseille, bâtiment Actilauze, 201 avenue des Aygalades, 13025 Marseille
- Laboratoire de l’Institut de génétique de Nantes Atlantique (IGNA), BP 70425, 19 rue Léon Durocher, 44204 Nantes cedex 2)
[6] Transferts secondaires d’ADN : quand le réel dépasse la fiction, de Patrice Reviron