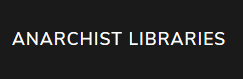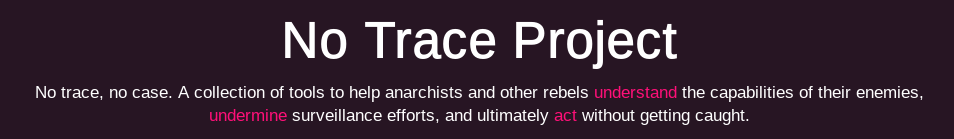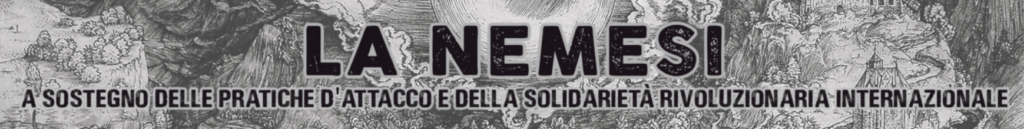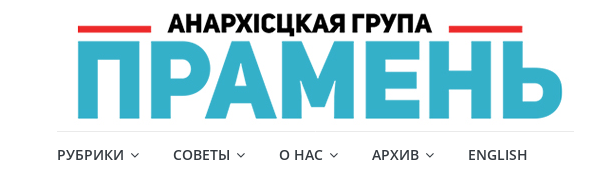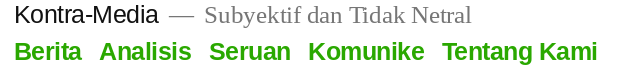La Nemesi / mercredi 2 novembre 2022
Le 20 octobre, l’anarchiste emprisonné Alfredo Cospito a entamé une grève de la faim de durée illimitée, jusqu’à la mort, pour l’abolition du régime de détention spécial 41-bis et du « fin de peine : jamais », la perpétuité avec période de sûreté illimitée, puisque les deux sont l’expression de la vengeance de l’État, par le biais d’une torture légalisée.
Une torture que l’État, précisément dans le cas d’Alfredo, utilise encore une fois, aussi contre les opposants politiques révolutionnaires… en plus que contre cette masse de détenus – environs 750, en date d’aujourd’hui, qui sont en 41-bis – que la justice considère comme membres d’une organisation de type mafieux, qui sont donc présentés à l’opinion publique comme des monstres et donc destinés, sans que personne ne bronche, à des traitements de tout type.
Aujourd’hui, ce compagnon est en train de nous dire quelque chose. Sa lutte est une lutte de dénonciation, par laquelle il nous jette à la figure que pour lui c’est mieux de risquer la mort, en se mettant en jeu encore une fois, plutôt que de vivre des années sans fin dans ces conditions, une suite ininterrompue, qui vise à son annihilation. C’est une attaque contre l’hypocrisie d’un État qui veut se décrire comme démocratique. C’est le masque qui tombe, celle de la manœuvre que ce même État est en train de mener. par son affaire, de façon que celle-ci constitue un précédent dans l’histoire.
En solidarité avec la lutte d’Alfredo, deux autres anarchistes emprisonnés, Juan Sorroche, détenu dans la section Haute sécurité 2 de la prison de Terni, et Ivan Alocco, détenu dans la prison de Villepinte, en France, ont commencé une grève de la faim, respectivement à partir du 25 et du 27 octobre.
Alfredo, détenu depuis 2012 dans des sections de Haute sécurité 2, fait aujourd’hui face à la décision du Tribunal de Cassation de redéfinir l’un des crimes pour lequel il a été condamné dans le procès Scripta Manent, avec Anna Beniamino, de « massacre ordinaire » en « massacre politique », dans la seule, manifeste, intention d’augmenter les années de sa peine (pour ce crime, la seule peine prévue est la perpétuité, qui peut être assortie d’une période de sûreté illimitée). Peu avant ce rendez-vous judiciaire, presque de façon à en influencer le résultat, Alfredo a été transféré en régime 41-bis, dans la prison de Bancali, à Sassari, un transfert motivé par sa condamnation pour « association subversive avec finalité de terrorisme » (270 bis), une association dont il est considéré comme le chef et le créateur.
Tout d’abord, par rapport à cet élément, en tant qu’anarchistes, qui refusent par principe les hiérarchies, les chefs et les structures verticales, nous y voyons un paradoxe interprétatif fallacieux. Tout comme le renversement de sens de l’accusation de massacre à l’encontre de compagnons et compagnonnes. Historiquement, en Italie, c’est l’État qui a effectué des massacres délibérés, parfois les couvrant du secret… d’État, et maintenant il accuse, par l’utilisation sophiste de l’appareil juridique et législatif, Alfredo et Anna de massacres qui, dans les faits, n’ont jamais eu lieu.
Après avoir aiguisé ses armes – un paquet de lois antiterroristes largement inclusives, la période de sûreté imposée aux peines écopées pour certains crimes et délits, des structures d’isolement total, pour enterrer vivants des personnes – l’État consume sa vengeance.
Par le transfert d’Alfredo en 41-bis, en mai 2022, Marta Cartabia, ministre de la Justice dans le gouvernement technique conduit par le banquier Draghi, a voulu atteindre le but de lui empêcher de continuer à exposer sa pensée anarchiste, de lui fermer la bouche et de l’enfermer pour le restant de sa vie en 41-bis. Cela parce qu’Alfredo n’a jamais arrêté, peu importe les conditions dans lesquelles il se trouvait, de mettre l’État et le capitalisme face à leurs responsabilités. Avec ses contributions à des initiatives publiques, des journaux et la publication de livres, qui lui ont coûté, pendant sa détention, d’autres affaires pour « association subversive » et « incitation aux crimes et aux délits », il a continué à participer, avec sa pensée, au débat anarchiste international, avec détermination et cohérence, en continuant à être une partie de ce que lui même définit souvent comme sa communauté, c’est-à-dire le mouvement anarchiste.
Le 41-bis vise précisément ce but : couper les contacts et la communication avec le monde externe. La poste est censurée, on n’a pas la possibilité de recevoir des livres – et de la presse de toute sorte – de l’extérieur, d’étudier, d’approfondir aucun argument qui puisse intéresser le détenu, tout passe au crible de l’Administration pénitentiaire, qui décide ce qui passe et ce qui ne passe pas. Un régime qui nie l’instruction, en plus de l’évasion mentale par le biais d’une lecture librement choisie, mais qui nie aussi la socialisation. En effet, sans prendre en compte l’isolement, imposé pour 23 heures sur 24, c’est toujours l’AP qui décide avec qui il peut échanger un « bonjour » : les ainsi-dits « groupes de socialisation » sont composés de 4 détenus maximum, et, en dehors de chaque groupe, il est interdit d’adresser la parole à quiconque. En cas de non respect de cette norme, on reçoit une plainte et ensuite un procès qui, s’il abouti à une condamnation, peut signifier encore plus d’isolement pendant la journée, ce qui veut dire l’isolement total. Il est interdit de garder en cellule même les photos de ses proches, de façon que même le souvenir du monde dehors, d’où ils t’ont arraché, ne survive pas. C’est une vie ? Non, c’est de l’annihilation menée de manière scientifique.
Le geste politique de ce compagnon anarchiste est un exemple de résistance et de la dignité d’un révolutionnaire ; en même temps, il s’agit d’un choix chargé de toute l’humanité d’un homme qui, malgré l’enfermement, reste un homme libre, qui, contraint dans les conditions d’isolement et de privation sensorielle extrêmes du 41-bis, décide de réagir et de ne pas se laisser enterrer vivant.
Le 41-bis, la « prison dure », a été introduit avec l’ainsi-dite « réforme Gozzini » de 1986, et à été suivi par la peine de réclusion à perpétuité avec une période de sûreté illimitée, qui se réfère à la réglementation de l’article 4-bis du code pénitentiaire. Élaboré au début des années 1990, dans le cadre de cette « législation d’urgence » de lutte contre la mafia, le 41-bis a été ensuite élargi aussi aux crimes de « terrorisme », pour les prisonniers politiques radicaux et révolutionnaires qui ont « osé » défier l’État et le capitalisme par la lutte armée et qui sont caractérisés par le fait d’être particulièrement « dangereux pour la société » (on n’est pas puni pour ce que l’on a fait, mais pour ce que l’on est). Face à l’accusation générique d’être dangereux pour la sécurité et la tranquillité publiques, il n’y a pas de défense possible, à part l’abjure, la prise de distance, la dissociation.
Déjà à partir des années 1970, quand la crise du système capitaliste et le développement d’un mouvement de classe et révolutionnaire fort et enraciné commençait à pointer son nez, les forces de la répression ont coagulé une stratégie unifiée, aussi en ce qui concerne les politiques pénitentiaires, commune à tous les pays européens et non seulement. En 1992, à l’article 41-bis, déjà introduit en 1986, a été ajouté un deuxième alinéa, qui permet au Ministre de la Justice de suspendre, à cause de graves raisons d’ordre et de sécurité publique, les normes de traitement et le règlement pénitentiaire, pour les détenus membres d’organisations mafieuses. En 2002, les possibilités d’application du 41-bis ont été élargies aux personnes détenues et condamnées pour des crimes avec finalités de « terrorisme et subversion ». Enfin, en 2009, l’article 41-bis, alinéa deux, a été institutionnalisé de manière définitive, en entrant dans le règlement pénitentiaire.
Nous devons être conscients que le virage autoritaire en cours en cette époque s’accompagne d’une politique de répression de l’« ennemi interne » qui est de plus en plus dure. L’État traitera avec le poing de fer des secteurs de plus en plus larges d’opposants et d’exploités, en utilisant cette menace répressive contre les mouvements de lutte contemporains.
Aujourd’hui, en Italie, les prisonniers politiques et les autres personnes accusées d’appartenir à la criminalité organisée qui sont enfermés en 41-bis sont plus de 700. Celui d’Alfredo est aussi, certainement, un geste de proximité, d’estime et de solidarité avec les autres prisonniers politiques qui se trouvent dans le même régime de détention et qui, avec cohérence, ne se sont jamais pliés. Toute notre solidarité va à eux aussi. Depuis 2005, trois révolutionnaires emprisonnés, militants des BR-PCC [Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente – Brigades Rouges pour la construction du Parti Communiste Combattant ; NdT], Nadia Lioce, Roberto Morandi et Marco Mezzasalma sont soumis, sans interruption, à l’isolement de la « prison dure », tandis que la camarade Diana Blefari a été « suicidée » après des années passées en ce régime de détention. Du période des luttes des années 1970 et 1980, onze camarades hommes et cinq camarades femmes restent actuellement en prison, avec des périodes de détention déjà effectués qui vont de 35 à 40 ans.
L’État continue à garder en taule les prisonniers révolutionnaires, après plus de 40 ans de détention : certainement non pas pour ce qu’ils ont fait par le passé ou parce qu’ils sont encore dangereux, mais à cause de l’histoire qu’ils représentent et en tant que mise en garde et moyen de dissuasion pour ceux qui, aujourd’hui, continuent à lutter.
Pour l’État, le 41-bis est permanent et pour en sortir il pose des conditions infâmes, c’est-à-dire collaborer avec l’État lui-même. Ceux qui refusent de collaborer avec la justice ne peuvent pas avoir accès à d’éventuels bénéfices ou à la libération conditionnelle (art. 58-ter) : concrètement, on doit se plier à la morale de l’État et balancer d’autres compas, donner d’autres hommes et d’autres femmes à la répression, troquer donc l’amélioration de ses propres conditions avec la vie de quelqu’un.e d’autre. Cela signifie que, même s’il nous fait la morale, l’État italien n’a aucune éthique, étant donné que cette torture psycho-physique, ce chantage violent, ressemble au vulgaire collaborationisme organisé pendant l’occupation nazi-fasciste de l’Italie, quand, pour un petit peu de thunes, on vendait par délation les Juifs qui se cachaient des déportations ou les partisans qui pratiquaient la guérilla. La démocratie italienne se comporte de la même façon que le fascisme et le nazisme d’il y a quarante ans : vendre quelqu’un pour sauver sa peau ou pour obtenir des primes ou des réductions. D’ailleurs, le crime de « massacre politique » (art. 285) a été créé par le Code pénal Rocco, pendant le fascisme, et il prévoyait la peine de mort (maintenant c’est la perpétuité avec période de sûreté illimitée), des lois contre-insurrectionnelles pensées pour éviter la guerre civile.
Avec les politiques répressives et de contrôle social, l’État essaye de garder le monopole de la violence, en s’acharnant brutalement contre ceux qui s’engagent dans la lutte pour la liberté et la révolution sociale. Il semble bien que l’action vengeresse de l’État soit voulue et complètement assumée, en tant que son instrument. Mais leur camp idéologique et politique n’est pas uni, en ce qui concerne la répression et la prison dure. Il y a une énorme
responsabilité des gouvernements et des politiciens de gauche et de centre-gauche, comme Oliviero Diliberto, qui, en février 1999, quand il était Ministre de la Justice, a officiellement créé le GOM [« Gruppo operativo mobile » de l’AP, ils sont l’équivalent des ERIS français et ils remplacent les matons ordinaires dans les sections du 41-bis ; NdT], le corps spécial des matons, et le « Bureau pour la garantie pénale », qui a des finalités « d’intelligence » en ce qui concerne les détenus, sous le commandement du général Ragusa, à l’époque directeur du SISDE [le service d’intelligence italien ; NdT], puis coordinateur de l’UGAP, le Bureau pour la garantie pénitentiaire de l’Administration pénitentiaire, une structure d’intelligence créé par ce même ministre Diliberto, en février 1999. Ce même Ragusa a été, jusqu’en 1996, le chef des groupes spéciaux des matons, qui ont été les responsables de passages à tabac et de tortures, comme ça a été le cas à la prison de Secondigliano en 1993 et à Pianosa en 1992 ; il avait déjà été le chef des ainsi-dites « équipes spéciales » internes à l’AP, qui, dans les années 1980, « géraient » avec leurs incursions les situations de crise
lors des révoltes dans les prisons. Des pratiques qui ont continué, comme si c’était normal, pendant des décennies, jusqu’aux quinze morts lors de la répression des révoltes de mars 2020, en différentes prisons de ce pays. Ces stratégies contre-révolutionnaires, que les États mettent en place pour continuer à garder en vie le système d’exploitation et de domination, atteignent le niveau de brutalité et de barbarie le plus élevé justement dans les prisons. Les mesures répressives créées entre 1977 et 1982 sont réutilisées et calibrées pour faire face, de manière autoritaire, aux nouvelles urgences et dans le but d’endiguer la dissension, d’autant plus aujourd’hui, quand la crise énergétique et économique et la guerre nous amènent vers des scénarios de possible conflit social interne. On sait que l’« exception » devient la règle. Le virage autoritaire produit par la crise du capitalisme génère une dure répression à l’encontre des anarchistes, avec des opérations répressives et des condamnations très lourdes, ainsi qu’une répression qui s’étend aux classes sociales qui subissent le plus la crise sociale, énergétique et environnementale : les exploités. L’État réprime de manière préventive la dissension contre les institutions et les patrons ; son but est de criminaliser et de décrédibiliser les pratiques révolutionnaires, afin de freiner le possible consensus vers les idées anarchistes, dans une époque d’opposition au capitalisme et à ses politiques énergétiques, qui pourrait ouvrir des brèches de critique radicale des folies nucléaires et technologiques. Voilà que, aujourd’hui plus que jamais, la lutte contre le nucléaire menée par notre compagnon Alfredo est d’actualité. Dans le système actuel, ce qui prévaut est la justice punitive, par contre la justice sociale est éclipsée par des inégalités toujours grandissantes. On réclame « des peines sévères et la certitude de la peine », tandis que dans les prisons les détenus sont entassés, oubliés, suicidés, assassinés, dans des conditions de dégradation physique et mentale à la limite de la survie.
La rhétorique et les sentences de l’appareil judiciaire bourgeois, à propos du caractère constitutionnel ou non d’une mesure répressive, donnent simplement libre cours à l’hypocrisie des droits de l’homme, typique des États occidentaux impérialistes, néocolonialistes et capitalistes, qui ont peu de choses à voir avec les droits de l’homme : quand la lutte de classe met en question les pouvoirs, l’État démocratique lui aussi découvre son vrais visage.
Il faut construire et encourager une grande mobilisation, à niveau international. Cette mobilisation doit avoir un caractère politique : porter les idées et les actions révolutionnaires des compas emprisonné.es, ainsi que développer la conscience de la solidarité.
La lutte d’Alfredo est aussi notre lutte !
Solidarité avec Alfredo, Juan et Ivan, en grève de la faim.
Solidarité en lutte avec les prisonniers et les prisonnières en 41-bis !
Quelques individualités anarchistes