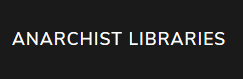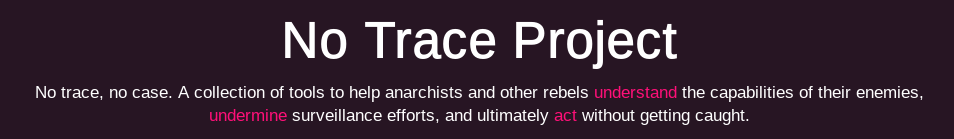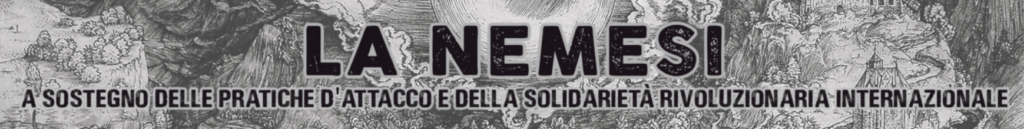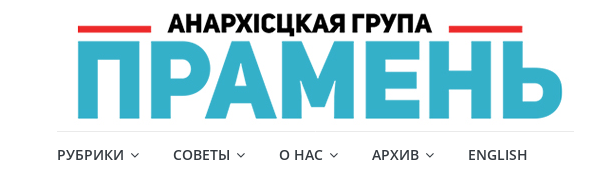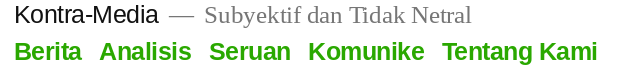Round Robin / mardi 10 décembre 2019
 Note de Round Robin : voilà enfin ce texte. Juan nous en avait parlé dans des lettres. On pensait qu’il avait été censuré. En effet on a su que le juge d’instruction l’a saisi, le 4 octobre, en le considérant comme une « provocation aux crimes et délits » ou, au moins, une incitation à l’« activité anarchiste » et l’a saisi pour sauvegarder la sécurité des forces de l’ordre.
Note de Round Robin : voilà enfin ce texte. Juan nous en avait parlé dans des lettres. On pensait qu’il avait été censuré. En effet on a su que le juge d’instruction l’a saisi, le 4 octobre, en le considérant comme une « provocation aux crimes et délits » ou, au moins, une incitation à l’« activité anarchiste » et l’a saisi pour sauvegarder la sécurité des forces de l’ordre.
On partage la volonté de Juan de le diffuser et on vous demande de le relayer.
« Comment faire pour qu’une goutte d’eau ne sèche pas ? La laisser aller dans la mer »
Dans ce texte, je raconte comment s’est passé mon arrestation, le 22 mai 2019. Je le raconte comme un fait, non pas pour dénoncer l’illégalité des méthodes de la police ou comme un récit victimisant.
Ça ne me va surtout pas que la façon dont mon arrestation s’est passée et ce qui a eu lieu pendant mon transfert à Brescia soit un secret entre moi et les agents de la DIGOS qui m’ont interpellé. Sincèrement, je n’ai pas envie qu’il y ait quelque chose de partagé entre moi et eux. Je ne veux rien partager avec eux, encore moins mes angoisses et encore moins « ce que l’on ne peut pas dire », comme un tabou, comme un pacte entre des « chevaliers machos » qui pourrait porter atteinte à ma virilité (?!).
Et enfin les mots prononcé au commissariat par un agent de la DIGOS (probablement du commissariat de Turin, au vu de ce qu’il sait sur moi…) habillé en motard, qui me conseille, en « ami », tel un frère ou un père, d’écrire seulement des lettres personnelles à des amis et pas des communiqués publiques. Cela m’a fait penser que partager ce qui s’est passé est une bonne idée.
Peu avant mon interpellation, j’étais en train de marcher dans la montagne et je suis passé par un chemin où j’ai rencontré un gros chien mi m’a menacé. C’était le même chemin que j’aurais dû prendre au retour. Je respecte beaucoup les chiens et si je peux je les évite, du coup au retour j’ai décidé de prendre la route vers Tavernola.
Là j’ai rencontré des cyclistes suspects : un d’eux avait une tête d’alcoolo plus que de sportif… plutôt quelqu’un qui passe toute la journée au café à boire et fumer… avec tout mon respect pour les alcoolos.
Ils m’ont demandé des informations. Je leur ai gentiment expliqué. J’ai eu des suspicions, mais j’étais trop sûr de moi et de ma connaissance du territoire, trop !
Du coup j’ai laissé de côté suspicions et paranoïa et j’ai continué à avancer.
Au troisième virage, j’ai vu trois voitures. Je me suis arrêté un instant. Je ne les aimais pas, mais j’ai continué à avancer.
Je n’étais pas sûr qu’il s’agissait de flics, je continuais à penser que ce n’était que de paranoïas, même si j’étais vraiment alarmé. En me rapprochant d’eux, j’ai vu deux personnes, chacune seule au volant de sa voiture. Ils étaient habillés en « montagnards ».
Ce qui m’a paru très bizarre (et là j’ai eu la certitude qu’il s’agissait de flics… je le sentais, mais j’étais déjà très proche de la première voiture) c’est qu’ils restaient dans leurs voitures, garées l’une derrière l’autre, sans se parler, immobiles.
Je ne pouvais pas revenir en arrière et au lieu de passer du côté passager, où il n’y avait personne, j’ai préféré passer à côté d’eux, de façon à pouvoir voir ce qu’ils faisaient et éviter qu’il me coincent au cas où ils sortiraient tous les deux. Quand j’ai dépassé la première voiture j’ai vu avec le coin de l’œil descendre le premier « montagnard », muni d’un bâton en bois.
J’ai pensé « Nous voilà ! ».
Je me trouvais devant la portière de la voiture du deuxième montagnard.
J’ai pensé qu’ils voulaient me suivre pour voir où j’allais.
Quand le deuxième montagnard est sorti, j’étais à 50 mètres d’eux.
A côté de moi, droite et gauche, seulement des montagnes.
J’ai pensé : c’est le moment !
J’ai donc sprinté et commencé à courir comme un fou ! En quelques instants, je les avais distanciés de 50 mètres. Je courais à en perdre haleine. Ils criaient et continuaient à me poursuivre.
J’ai continué un peu, en les laissant à une centaine de mètres, peut-être plus, derrière moi. Mais j’avais peur qu’une autre voiture de police arrive de la route sur laquelle je courais, ce que je pense est effectivement arrivé par la suite.
Ils criaient quelque chose, je ne sais pas quoi. Sincèrement, je n’entendais rien, je n’avais pas peur, mais tellement d’adrénaline dans le corps que je ne comprenais plus rien. Mon cerveau courait… trop ! J’étais hors contrôle, comme un animal emballé. Je ne pouvais pas continuer, et parce qu’ils avaient les voitures et à cause du rythme de ma course.
J’avais deux chemins pour continuer à fuir et me cacher, mais j’ai choisi la mauvaise. Sincèrement, j’avais perdu le contrôle. Si j’avais réussi à garder ma rationalité, j’aurais suivi l’exemple de l’instinct des sangliers, qui, dans des situations d’urgence, courent toujours vers le bas de la montagne, parce que comme ça on cours plus vite et c’est plus facile de s’enfuir, au lieu de monter, comme je l’ai fait…
A ma gauche il y avait une berge qui descendait de 3 ou 4 mètres, à ma droite ça montait, de 4 ou 5 mètres.
Je n’étais pas lucide et j’ai fait un saut vers ma droite, jusqu’à la moitié de la montée. Je glissais, mais j’ai réussi à monter presque jusqu’en haut. En bas, étaient arrivés 3 ou 4 flics.
J’étais épuisé. J’étais tout en haut, j’aurais pu aller vers la forêt, mais je ne voyais rien à cause de l’agitation.
C’était une sensation étrange : je me suis rendu à cause du manque des forces, mais en me rendant, j’ai eu l’impression que continuer vers la forêt aurait été dangereux, pas tellement à cause de la forêt, ni des menaces, que je n’entendais même pas. Il s’agissait plutôt un instinct animal de survie. Je me suis rendu et quand je me suis retourné j’avais le pistolet du flic braqué sur moi. Je ne crois pas qu’il voulait tirer, mais… ?
Du coup je suis revenu et je me suis laissé traîner en bas du ravin. Là ils m’ont empoigné et jeté à terre. Ils étaient très agités et très énervés (on sait qu’ils s’énervent quand on les fait courir !). Quand j’ai été à terre, ils m’ont mis sur le ventre, peut-être il y a eu des coups de pieds, je ne me souviens pas bien, mon cœur battait encore la chamade. Quand j’étais immobilisé, une voiture est arrivée. Ils ne m’ont pas menotté, juste immobilisé avec les mains derrière mon dos, et m’ont chargé sur la banquette arrière, couché sur le ventre, avec un flic assis sur moi, me tenant les mains. Le conducteur et l’autre flic assis devant ont commencé à me fouiller, pour ainsi dire : ils m’ont littéralement déchiré les habits. J’avais un petit sac à dos de 22 litres, dont ils ont déchiré toutes les poches. Après une centaine de mètres, la voiture s’est arrêtée, la portière près de ma tête s’est ouverte et quelqu’un, depuis l’extérieur, a commencé à me donner des coups de poing sur la tête, sur l’os temporal et sur la tempe. Sincèrement, je n’ai rien senti. Après, ils m’ont mis les serre flex aux poignées, ils les ont tellement serrés que la circulation du sang dans les mains a été bloquée. Puis, ils m’ont mis en place (une position réfléchie, je crois) : les jambes vers le conducteur, là où met ses pieds le passager assis derrière lui, mon postérieur au milieu de la banquette arrière, la tête entre les deux sièges avant.
Mon corps faisait un « U ». Le flic assis sur le siège passager gardait mon visage dans un étau (si vous essayez vous verrez que c’est un bon étau), avec le pouce planté entre cou et mandibule et les autres quatre doigts sur le visage, qu’il m’écrasait sur le côté de son siège. Je ne voyais presque rien : un œil était fermé par les doigts du flic, l’autre écrasé contre le siège.
Sur la banquette arrière, mon cul et mon dos au milieu, un flic à droite et un à gauche.
On est partis. Le flic de devant a commencé à me demander : « Où crèches-tu ? ». Je n’ai pas répondu. Je ne parlais pas. Alors celui assis à ma gauche a commencé à m’écraser un rein avec son coude, jusqu’à quand j’ai commencé à crier, et ils continuaient à me demander « Où crèches-tu? »
Moi, silence.
On l’a encore écrasé le rein. J’essayais de ne pas crier et de ne pas parler, mais c’était une douleur bizarre et très forte. Je ne pouvais pas retenir un gémissement. Après, il a appuyé encore et je lui ai dit que je dormais dans la montagne. Il y avait un bordel dans ma tête et j’avais peur que si je commence à donner des réponses, les « écrasements » du rein et les questions auraient augmenté, des questions auxquelles en théorie je n’étais pas obligé de répondre. Je ne voulais pas répondre. J’avais peur, mais pas seulement. Entre-temps, quelqu’un d’eux me disait : « Tu aimes poser des bombes ? » « Et si tu tuais un père de famille ? » « T’aimes faire le maquisard, hein ? »Maintenant tu vas voir ! » « Tu pues comme un berger ! »
Oui, je puais le bouquetin et la fumée du feu… bizarre le cerveau, j’ai pensé « qu’est ce qu’il y a de mal avec les bergers ? » (sic!). Il me semblait bizarre de faire de telles réflexions, si « légères », dans une situation si compliquée ! Quand le flic m’écrasait à nouveau le rein, mon cerveau partait en vrille, dans un mélange de changements soudains entre peur, excitation, courage, découragement. Le tout en une fraction de seconde. Des changements continuels dans un vortex de pensées, à une vitesse impressionnante. Puis j’ai pensé au zen. Je ne rigole pas. J’ai respiré et j’ai pensé « Comme ça, ça va pas ! Je ne dois pas lutter contre mon douleur et mon angoisse, plutôt me laisser aller. Les accepter ». Je le sais, ça fait hippie, mais ça s’est passé comme ça.
Je devais me laisser aller au lieu de rester rigide comme je l’étais ; j’étais faible et entravé. Du coup j’ai compris une chose : toutes les fois qu’il m’écrasait, si je criais, même avant qu’il me fasse mal, il arrêtait. De plus, dès qu’on me posait une question, si j’attendais le bon moment entre question et « écrasement du rein », je pouvais crier et donc éviter de répondre. Et je continuais à crier, de façon à ne pas avoir à répondre à leurs questions. Je le sais, ce n’est pas très digne, mais on s’en fout ! C’était une tactique efficace.
A un certain moment du voyage (entre Mamertino et Brescia il y a peut-être quarante minutes de voiture), après 10-15 minutes, je ne sentais plus mes mains, même pas le picotement, je crois à cause des serre flex. Et de temps à autre le flic qui m’écrasait le rein demandait à l’autre si mes mains étaient bleues. Il lui répondait avec des geste et je ne pouvais pas comprendre ce qu’ils disaient… je ne sais pas, peut-être que c’était pour me faire peur. En tout cas, je ne sentais plus mes mains et la position dans laquelle j’étais était horrible : mon corps en « U » les jambes qui picotaient et dès que je bougeais un peu, l’autre m’écrasait le rein.
Ils ne m’ont pas posé beaucoup de question, seulement « Où tu crèches ? ». Mais après les premiers 10-15 minutes, ils n’ont plus rien demandé. Ils ont « juste » continué de m’écraser le rein quand je bougeais. Mais d’une certaine façon, c’était un soulagement de ne plus être questionné. Je voulais seulement arriver au commissariat, au moins s’ils me tabassaient ça n’aurait pas été dans cette position !
Après une demi-heure, 40 minutes, on est arrivés au commissariat de Brescia, au siège de la DIGOS. Pendant les dix derniers minutes, les flics étaient plus calmes et, même si mes mains sans circulation, ainsi que la position, étaient encore très gênant, au moins ils avaient arrête de m’écraser le rein !
Arrivés au commissariat de Brescia, ils m’ont déchargé par terre, comme un paquet, et ceux qui attendaient là ont commencé à me donner des coups de pieds. Quelqu’un leur a dit de se calmer. Ils étaient surexcités. Moi un peu moins, étant donné que maintenant j’étais allongé et qu’on m’avais enlevé les serre flex… quel soulagement !
On m’a enlevé les chaussures pour voir s’il y avait quelque chose à l’intérieur. A partir du moment où je suis entré dans le commissariat, la situation a complètement changé et ils ne m’ont plus touché ! Au contraire… ils m’ont traité de façon très correcte, à un tel point que je le trouvais suspects. Chaque fois que je voulais aller aux toilettes on m’y amenait, on m’a donné de l’eau et même des chocolats (comme à un singe dans sa cage ! Eh eh!). Je suis resté menotté, mains dans le dos, de 11h à 22h, assis sur une chaise dans un bureau avec deux ou trois agents de la DIGOS, cagoulés, qui montaient la garde. Il y en avait pas mal, dans ce commissariat. Parmi eux, certains me « connaissaient » assez bien : le rocker qui m’a conseillé de ne pas écrire de communiqués ; le chef de la DIGOS de Brescia, un homme ; puis une femme, je ne sais pas si elle est un juge ou le chef de la DIGOS de Venise. Le chef m’a demandé de collaborer et parler des clefs que j’avais sur moi, en disant que de toute façon ils auraient découvert où j’habitais. J’ai répondu que je ne savais pas de quoi il parlait. Il n’a pas beaucoup insisté… deux ou trois fois, et il disait qu’il savait, en faisant référence à l’inculpation pour l’attaque de Trévise, que c’était moi le coupable… vivement la présomption d’innocence ! Je lui ai dit que c’était pas à lui de juger. Puis, à 22h, on m’a amené à la prison de Brescia.
J’écris tout ça pour raconter comme je l’ai vécu. J’étais très agité et peut-être que les choses ne se sont pas passées dans cet ordre, mais mes sensations ont été celles-ci, avec milles sensations contrastantes, je ne les ai pas agrandies ni diminuées. Je sais qu’on ne m’a pas traité avec des gants de velours, mais je ne me plains pas. Sincèrement, je ne me sens pas, ni je pense d’avoir été torturé, ni tabassé durement. Mais le fait qu’ils ne l’ont pas fait avec moi, n’enlève pas le fait qu’ils l’ont fait avec d’autres ! Des assassinats, comme l’affaire Cucchi, l’affaire Frapporti à Rovereto, l’affaire Uva [personnes tuées par les flics ces dernières dix années en Italie ; NdAtt.], l’assassinat de Carlo Giuliani, de l’anarchiste Pinelli, tué dans le commissariat de Milan par le commissaire Calabresi, les tortures dans la caserne Bolzaneto pendant le G8 de Gênes, ainsi qu’à l’école Diaz, etc. etc. Ce sont des choses qui ont lieu, et elles sont STRUCTURALES à tout État, capitalise ou pas ; il ne s’agit pas, comme la loi veut nous le faire croire, d’une exception, d’un erreur ou de bavures à corriger, non ! Je le dis encore, cela dépend de la structure de l’État et de cette société.
Il faut tout s’attendre, à tout moment, de la part de l’ennemi ; il faut garder cela à l’esprit et le souvenir aussi aux autre : l’État et ses forces répressives en général n’ont jamais respecté et jamais respecterons leur sacro-saints droits et lois, même s’ils disent le faire : ils ne nous laissent passer même pas une petite infraction, qu’on paye parfois avec des mois de prison. Mais seulement pour les pauvres ! Jamais pour les privilégiés, les politiciens, les puissants des entreprises multinationales et des banques, ou les flics de toute sorte : ils sont régulièrement acquittés. Deux poids, deux mesures ! On le voit chaque jour, au Parlement, dans les tribunaux, dans les rues et les prisons. Tout cela sans retenue et sans honte !
Cela ne m’intéresse pas, un État plus juste, ou parfait, ou encore des droits constitutionnels. Ils seront toujours des instruments de soumission et d’exploitation dans les mains de l’État autoritaire.
Les concepts de « légal » et d’ « illégal » appartiennent à l’autorité, il existe dans l’intérêt de peu de monde, de leur hypocrisie.
Pour nous, il faut…
« Il faut lutter et lutter encore, afin que la disproportion finisse »
Et quel qu’il soit le chemin que nous sommes en train de parcourir, que ce soit avec le cœur ! Pour l’Anarchie !
Juan Sorroche
AS2, Prison de Terni
septembre 2019
Pour lui écrire :
Juan Antonio Sorroche Fernandez
C. C. di Terni
Strada delle Campore, 32
05100 – Terni (Italie)