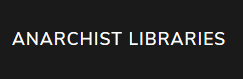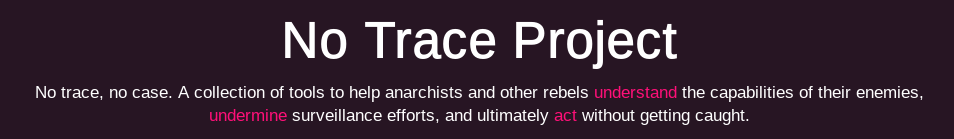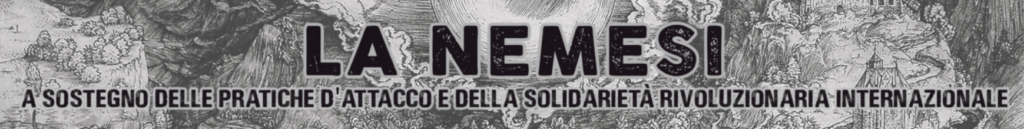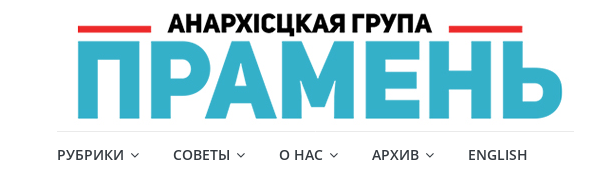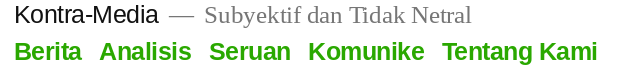IAATA.info / lundi 25 mars 2019
Pour quelques bouts de shit, pour avoir aidé des sans-papiers, parce qu’on s’est fait serrer par le vigile à la sortie du magasin ou bien quand on se fait tirer du lit par des flics qui enchaînent sur une perquis’… la police s’attaque à tous ceux qui ne marchent pas assez droit ; à tous ceux qui refusent de jouer au jeu du bon citoyen ; à ceux qui, partout, ont décidé ensemble de ne plus avoir peur, ceux qui se défendent, frappent et s’organisent. Malgré les précautions, les habitudes de prudence, les tactiques d’évitement, en dépit de toute opacité, il arrive que ça tombe. La répression s’abat : quelque chose dans nos vies l’a fixée, aimantée.
Ça tombe et ça fait mal. Les bonnes âmes diront que c’est injuste, disproportionné. 6 mois fermes parce qu’on n’a pas couru assez vite, parce qu’on était au mauvais endroit au mauvais moment. Des années à crever derrière les murs pour un soupçon, un vague témoignage. Mais ce n’est pas tant que les flics et les juges frappent mal ou à côté. Simplement, l’incrimination d’individus (coupables ou innocents, là n’est pas la question) n’est que la partie la plus visible du mécanisme : il faut surtout « faire un exemple », « les peines requises par le parquet sont exemplaires »… Dans un État démocratique, la répression ne vise pas tant à anéantir brutalement ce qui lui échappe — élément par élément — qu’à contenir ce qui déborde, en l’affaiblissant. Il s’agit de gérer la délinquance et la contestation en tant que phénomène général plutôt que de mettre hors circuit, un à un, tous les éléments à risque. Au cœur du dispositif policier, il y a cette fonction d’intimidation : en frapper un pour terroriser tout le monde.
La police frappe à la porte, elle casse des dents, les juges font tomber de lourdes peines sur les têtes folles… On en prend plein la gueule, on est dans le dur. On est dans le réel aussi, la répression tombe comme une épreuve de réalité : jusqu’où on tient nos engagements ? Quelle place on fait à la peur, aux doutes ?
Le pire évidemment c’est de lâcher, céder sur tout, se faire l’auxiliaire de son propre anéantissement. Le choc des arrestations, la lourdeur des surveillances viennent casser des élans, engluer des dynamiques ; combien de collectifs émiettés, d’amitiés perdues quand la pression policière se fait pesante ? « Le jeu n’en vaut pas la chandelle » ; « Maintenant je me suis rangé ». Rangé dans l’ordre des choses, à la merci de la vie normale, isolé. On finit par intégrer que cette vie-là est préférable au risque de prendre de la taule pour une pierre jetée sur un flic. On oublie que cela constitue essentiellement une menace flottante destinée à paralyser les offensives. On cède à l’image-repoussoir de la prison, on en vient à en avoir une crainte démesurée. On finit par rentrer dans leur jeu morbide, à se plier à leurs travaux et à leurs soins forcés, parfois sans attendre qu’un juge ait prononcé ses injonctions thérapeutiques ou l’obligation de « trouver un emploi salarié ».
On finit par oublier que la répression — et toute sa « démesure » quand elle s’abat — est justement là pour ça. Face à la police, face à la justice, la première réponse, la réponse minimale, c’est de trouver des modes pour continuer, des modes qui, malgré une amputation temporaire (par la taule par exemple), permettent que tout ne soit pas – gangrené. Tout ce qu’on construit, les liens, l’intelligence commune, les petites certitudes… tout est mis à l’épreuve : ça résiste ? Alors c’est du solide.
Bien sûr, il y a des ajustements. Avec un procès au cul, la question se pose souvent à titre personnel : « qu’est-ce que je fais maintenant ? Est-ce qu’il faut se calmer ? Pendant combien de temps ? » Et il y a toute la mécanique collective autour : comment on continue avec une personne incriminée ? Ce qu’on peut faire ou pas avec elle, comment on se débrouille pour éviter qu’elle se refasse serrer… Arriver à ce que tout le monde refuse de donner son identité pour la couvrir, trouver des faux noms à filer en pâture aux keufs, se donner les moyens d’organiser une cavale. La répression ouvre aussi de nouveaux territoires à explorer, en matière d’organisation, de complicités. Bien sûr c’est lourd : les précautions sans fin, les ruses à répéter, le temps suspendu à des enquêtes qui traînent en longueur, qui n’en finissent plus… Mais il faut se mettre à la hauteur, et on a des choses à y gagner. Faire avec, trouver un mode propre qui permette de continuer à vivre, sans faire en permanence exister la police dans nos têtes.
Car l’efficacité de la répression ne tient pas que dans le renoncement qu’elle parvient à provoquer, mais aussi dans ses implications internes, pernicieuses. Elle nous attire en terrain ennemi, sur le terrain de l’État ; elle transforme intimement ceux qu’elle a dans le viseur. On s’embarque facilement sur de mauvaises pentes, des mauvaises pentes qui semblent prendre à travers nous, et font exister les effets de séparation liés à la répression : tentation du repli sur son petit groupe, séparation d’avec ses positions éthiques, spécialisation dans une activité anti-répression qui absorberait tout, les énergies, les perspectives de lutte…
Reste la voie étroite, celle qui suit l’accumulation patiente de petites précautions qui parviennent à donner du champ, la possibilité de faire avec et de reprendre l’initiative, tout en échappant à la paranoïa qui enferme complètement, même dehors.
REPLI
On a peur, on verse dans la paranoïa qui fait exister la police à tous les coins de rue, et jusqu’en nous-mêmes. Les précautions maniaques, les contres-mesures rendent tout pesant, épuisant. La charge vive est petit à petit neutralisée. Les actions se font plus lentes. Comme une longue dépression collective : la démoralisation n’est pas affaire de défaillances psychologiques mais plutôt un effet de lenteur qui complique les contacts et facilite les embrouilles.
Les compositions collectives un peu larges se désunissent : les tensions s’exacerbent dans les quartiers, dans les milieux, les collectifs volent en éclat… Le repli et les crispations identitaires deviennent des ressorts parfaits pour des opérations policières qui se mettent à nous travailler même sans que les flics soient effectivement présents. Le bavardage, la rumeur, plus ou moins publics, plus ou moins malveillants, sécrètent leurs propres opérations d’identification : on dit du mal de la « bande à machin », on reprend à bon compte les catégories des flics, on emprunte nous-mêmes la panoplie des gangsters ou du black bloc. Les divergences se font dissensions voire mises en accusations publiques, condamnations morales de toutes sortes. C’est le règne des guéguerres ou de la guerre tout court, du temps passé à se baver dessus ou se déchirer plutôt qu’à éclaircir des positions, reconnaître la multiplicité des tentatives politiques ; au moment où la répression s’abat, ces divisions participent de la neutralisation préventive tant recherchée du côté de la police. Diviser pour mieux régner. Classique.
Parfois la taule vient carrément couper des liens : au début, on écrit, on demande des nouvelles et puis, petit à petit, les gens qui sont tombés se font manger, avaler derrière les murs.
Il est logique dans ce contexte de se replier sur sa bande, sur son petit groupe de potes. Au risque de tomber dans des dynamiques groupusculaires, marquées par un isolement forcené et toute l’impuissance qui va avec. Les flics surveillent : soyons discrets, mutiques. Petit à petit, on se peuple de secrets bien lourds qui empêchent de penser et d’agir facilement avec d’autres gens. Ça rogne doucement toute aptitude à la rencontre (« c’est pas un infiltré, un indic ? », « est-ce qu’on peut s’afficher comme ça ? »).
La dérive groupusculaire, c’est aussi la tentation du face à face avec l’État. Au risque de devenir des petits États en puissance. Parce que les chefs apparaissent lorsqu’il s’agit de faire face à la crise. Parce qu’on ne joue plus, il faut assurer, être efficace, quitte à tomber dans la militarisation. Des chefs, des sous-chefs, des soldats… La spécialisation : qui fait la logistique, qui est le stratège, qui est un gros bras, etc… Les alliances ne sont plus que stratégiques et tous ceux qui s’écartent des consignes de l’état-major deviennent suspects. Des traîtres. C’est aussi le piège de l’escalade grâce auquel l’État fabrique finalement « ses » terroristes, l’alter ego avec lequel il sait bien comment procéder. Assécher le bassin, traquer, neutraliser. La bande ou la cellule se meut dans un environnement entièrement hostile. C’est eux et nous. Et la population. « Des gens qui ne savent pas, qui n’ont rien compris, des complices du pouvoir »… On en oublie cette vérité essentielle : la « population », ça n’existe que dans la tête des gestionnaires et des gouvernants.
L’histoire récente témoigne que ce pli menace toute lutte offensive. Mais même sans aller « jusque là » (jusqu’à la militarisation ou la clandestinité armée), il y a le risque d’être piégé dans un face à face avec la police. Piégé dans des identités closes, nos propres caricatures de cailleras, de casseurs, d’anarchistes véritables. N’exister que négativement, dans une sorte de réactivité perpétuelle. Perdre toute souplesse. Appauvrissement de tout ce qu’on est encore, et de tout ce que l’on pourrait devenir.
L’ENNEMI PUBLIC, LA VICTIME, L’INNOCENT
Il y a encore une sorte de tentation inverse : il ne s’agit plus de se recroqueviller mais de faire beaucoup de bruit, en faire toute une affaire, s’en remettre à l’opinion. Rendre une affaire publique, ne pas laisser le champ complètement libre aux manœuvres policières et judiciaires est évidemment une carte à jouer : l’expérience montre bien qu’on mange moins si la salle d’audience est remplie, si une petite troupe de gens fait du bruit devant un commissariat ou un palais de justice. Et ce n’est sans doute pas un hasard si les ouvriers de Continental ont pu saccager une sous-préfecture sans finir derrière les barreaux (et ce malgré les images gracieusement fournies au procureur par TF1).
Une publicisation très large peut même gêner le travail d’enquête, brouiller les pistes ; ça peut permettre de diffuser des infos sans prendre le risque d’offrir trop de connexions aux flics dans les moments les plus chauds.
Mais dès qu’une affaire fait du bruit, on peut rapidement être encombré par certains soutiens, certaines présences, qu’on est allé chercher ou qui ouvre leurs gueules d’eux-mêmes : familles affolées, politicards dans le vent, personnalités de la société civile… « D’autres » qui viennent raconter des saloperies ou tirer sur l’ambulance. Et c’est alors compliqué de rattraper le cours de l’affaire contre tout ce bavardage : il faut tenir des positions claires sans trop se découvrir, sans trop confirmer les soupçons… Reste alors l’option d’un silence stratégique. Un silence offensif. Quand les actes parlent d’eux-mêmes. Des gestes que les discours indignés viennent immanquablement trahir.
Rendre publique une histoire, ce n’est pas forcément jouer le jeu des grands médias. N’empêche, la question de la médiatisation se pose toujours, bon gré mal gré, que le « coup de filet » ait été accompagné d’une grosse couverture médiatique ou pas. Quiconque se fait choper à la sortie du supermarché avec un fromage de chèvre dans la poche ne fera pas la Une du JT de TF1, mais son geste est de toute façon pris dans un ensemble de discours régulièrement relayés par la machine médiatique (l’enquête annuelle sur le vol à l’étalage, l’étude sur le coup de la délinquance pour la société — « 6 % du PIB, tout de même ! » — , les incessants reportages ou séries télé qui mettent en scène gendarmes et voleurs, etc.).
Le terrain médiatique est un terrain d’affrontement, lui aussi. Un terrain miné, bien sûr, dans lequel il est difficile de manœuvrer, parce que sa configuration même nous est hostile — tout comme une grande avenue haussmanienne vidéo-surveillée est peu propice à nos affaires, d’ailleurs. Le risque c’est notamment de se retrouver coincés à devoir jouer les seuls rôles assumables dans le champ médiatique : l’innocent ou la victime, d’activer toute une grammaire de la justification publique, du consensus républicain. On se retrouve avec des associations à la « AC le feu » qui prétendent faire du bruit autour de l’assassinat de « jeunes des quartiers » par les flics en réclamant plus de justice ou une police plus professionnelle… Ou avec des pétitions d’intellos qui veulent soutenir les inculpés de Tarnac au nom de « l’état de droit », c’est-à-dire précisément au nom de l’ordre en place qui, pour garantir la « liberté d’expression » et la démocratie, se blinde de dispositifs sécuritaires et de législations antiterroristes.
Nous n’avons aucune vérité commune avec un juge ou un flic. Voilà déjà pourquoi il n’y a rien assumer devant eux, rien à leur avouer, sans même parler de balancer des gens. Se taire, nier, mentir pour s’en sortir et reprendre la lutte. La difficulté, c’est qu’en médiatisant un procès ou une affaire, on risque toujours de transformer cette option tactique en proclamation d’innocence : une position qui appelle à bien différencier les innocents des coupables, qui justifie d’autant plus l’innocence de certains qu’elle en incrimine d’autres, ceux qui se sont fait serrer sans les appuis, sans le capital social qui permet de bien amorcer les campagnes médiatiques. Au risque d’alimenter la machine à faire le tri entre les bons militants alternatifs ou syndicaux et les méchants extrémistes violents, entre les jeunes-qui-essaient-de-s’en-sortir et les racailles.
C’est évidemment depuis une position de force qu’on a le plus de chance de pouvoir manœuvrer dans le champ médiatique, sans trop de dommages et ce rapport de force peut émaner d’un mouvement social de grande ampleur ou ressortir plus concrètement de l’occupation d’un plateau télé. Manœuvrer, c’est-à-dire réussir ce numéro d’équilibriste qui permet de retourner une attaque subie en possibilité d’affirmations. Bien sûr, on peut d’autant plus facilement affirmer quelques idées clairement quand on a les moyens de les diffuser largement, sans prendre le risque de se faire couper au montage : impression massive de tracts, d’affiches ou de journaux, utilisation d’internet (des sites d’information autonomes, des réseaux sociaux à la facebook en passant par youtube ou les listes de diffusion), passages sur les dernières radios libres, etc.
LA TÊTE CONTRE LES MURS
Quand des gens tombent sont emprisonnés ou placés sous contrôle judiciaire, on risque de verser assez vite dans l’anti-répression. Une part de l’entourage se retrouve investi dans le soutien logistique ; trouver la thune pour les avocats, les mandats ou la famille, faire le lien intérieur-extérieur, assurer le travail de liaison entre les gens qui n’ont pas le droit de se capter et préfèrent pour un temps ne pas courir le risque… Dans le soutien « politique » aussi : faire du bruit autour de l’affaire, gérer les embrouilles potentielles, colmater les brèches pour faire en sorte que les flics ne puissent pas ramasser d’autres gens trop facilement… On mobilise tout son temps, toutes ses énergies sur du défensif. En un sens la répression porte à travers tout ce travail, dans la mesure où elle vise la paralysie ou l’affaiblissement des forces rebelles, jusqu’à un « seuil raisonnable ».
Faire la part entre le soutien indispensable et le piège de l’anti-répression est évidemment délicat. C’est peut-être une affaire de seuil. D’ambiance aussi : on traîne une impression d’impuissance, le sentiment d’être bloqué en réaction, de délaisser systématiquement l’offensive. Dépression latente. Pour s’en sortir il y a la nécessité de construire des outils un peu durables ; pour ne pas être pris au dépourvu et ne pas s’épuiser non plus à les bricoler dans l’urgence : ça peut vouloir dire soigner les contacts avec les avocats, dans les taules, mettre en place des caisses de solidarité pour que la thune soit facilement déblocable. Être au clair sur la manière de faire passer des infos et du matos dans telle ou telle prison.
Et surtout ces outils, ces tactiques il faut les inventer parmi d’autres. Parmi tous les moyens de mise en commun, de débrouille collective. Savoir faire avec et contre la taule comme on sait faire avec et contre les galères du taf, du Pôle Emploi, des plans logement. La prison ou le contrôle judiciaire ne constituent pas des thèmes de lutte ni même la cause ultime d’un mouvement de contestation antisécuritaire. Ce sont des dispositifs parmi d’autres, des dispositifs auxquels on s’affronte et dans lesquels on peut nouer des complicités, des solidarités qui donnent de l’air ; dedans comme dehors.
Chaque situation de répression, en même temps qu’elle risque de nous affaiblir ou de nous casser pour de bon, crée des occasions. Occasions de rencontres. En taule, la fameuse « école du crime », où malgré tout des connexions se créent, où les activités obscures et clandestines qu’elle prétend réduire trouvent à se recomposer. Et ça passe les murs. Les amitiés de l’intérieur débouchent sur de nouveaux plans dehors.
Des rencontres à l’extérieur aussi, en allant au parloir, en se retrouvant dans les mêmes angles morts au moment de faire passer un colis en promenade. Des petits événements où s’éprouve un commun qu’on n’aurait pas forcément imaginé ; des rencontres qui peuvent durer, poser quelque chose dans le temps, le début d’une alliance, des promesses pour le futur.
Parfois émergent des compositions improbables, de plus en plus de monde se laisse aller à des rapprochements intempestifs : entre le déploiement de l’arsenal législatif et l’impasse sécuritaire à laquelle il nous condamne ; entre les descentes de la S.D.A.T. et celles des flics ou des gendarmes, avec fouilles au corps et chiens policiers, dans les bahuts ; entre la mobilisation contre le fichier E.D.V.I.G.E. ou le fichage A.D.N. et l’incendie du centre de rétention de Vincennes.
Des solidarités, des processus politiques à l’œuvre parfois depuis longtemps mais qu’on ne savait pas toujours ressaisir se dévoilent, s’affinent : quand les commerçants d’une cité prennent en charge de collecter du fric pour des jeunes en détention provisoire, quand une mairie est occupée pour reprendre ce qui a été arraché, quand tout un village se retrouve dans un comité de soutien, quand le petit patron d’une boîte de bâtiment signe sans rechigner deux promesses d’embauche pour faire sortir des gens en semi-liberté. Ailleurs une assistante sociale brûle des documents qui pourraient donner trop de billes aux flics, on fait passer des téléphones portables à des prisonniers en activant des vieux liens de voisinage…
C’est le seul vrai moyen d’échapper aux effets de la répression : des liens qui font que les flics ne peuvent pas prendre quelqu’un sans arracher tout un bordel en même temps, ce qui peut vite devenir ingérable pour eux.
Plutôt qu’isoler des coupables, la répression se charge alors de mettre en communication différents foyers de révolte (syndicalistes, sauvageons, lycéens remuants). Plutôt que de terroriser les plus agités, la répression accentue la nécessité de diffuser et d’assumer des pratiques illégale et clandestines, depuis la lutte de soutien aux sans-papiers jusqu’aux mouvements lycéens. Les analystes, anxieux, parlent de radicalisation.
Et même les syndicalistes policiers le déplorent : en dépit de la multiplication des forums police-population, la répression ne rassure plus les honnêtes citoyens, elle diffuse surtout l’hostilité face aux forces de l’ordre.
[Texte extrait de la brochure « Aux ennemis intérieurs », publiée en 2010]