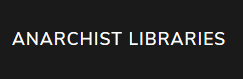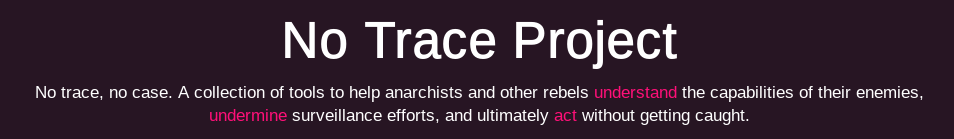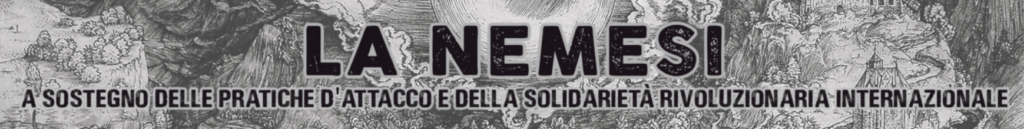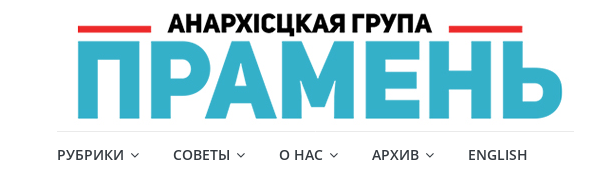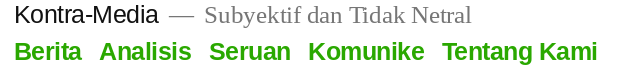Dégénérations
Entre fierté et victimisme de genre
 Vetriolo, giornale anarchico n° 3 / hiver 2019
Vetriolo, giornale anarchico n° 3 / hiver 2019
Je suis anarchiste, je ne suis pas féministe parce que je vois le féminisme comme un repli catégoriel et victimiste ; je n’ai jamais fait des discriminations liées au genre, même si je n’utilise pas de conventions linguistiques dé-genrées, au contraire j’utilise souvent un langage vulgaire et politiquement incorrect. Je pense que, dans la recherche de l’anarchie, c’est à dire dans la pratique de rapports anti-autoritaires, l’annulation des privilégies et des oppressions liés au genre est déjà présente – et elle est à cultiver. Ah, j’oubliais, je déteste la pratique de l’autoconscience en publique et je considère les assemblées comme un instrument sans tranchant. Je comprend les autres et j’ai la volonté de les rencontrer, mais je vois que trop souvent l’assemblée tombe dans une auto-représentation stérile.
Voilà, de ces temps on risque de devoir commencer avec un préambule de ce type, pour entrer dans le guêpier des lieux communs sur le genre et le féminisme, se démêler dans la très emmêlée incapacité à se rapporter aux autres, propre à la galaxie anarchiste, avec un panel de comportements qui va de l’hyper-émotivité au calcul bureaucratique de la position à prendre (et du niveau de compromis à négocier) dans une lutte. Je ne crois pas qu’on puisse combattre des comportements autoritaires et sexistes avec la tentative de diffuser des nouvelles conventions linguistiques et avec le remaniement à la sauce alternative de quelques morceaux de rhétoriques officielle indignée (entre hashtags, listes de féminicides à la télé, prides, chaussures rouges et rubans arc-en-ciel).
Il faudrait plutôt reconnaître tout cela comme des symptômes de l’énième opération de déconstruction de tout sens véritable et de la récupération qui est en cours. C’est à dire que, tout en pensant qu’on s’y oppose, on est de facto en train de se conformer aux codes normatifs et de comportement qui sont donnés par le pouvoir comme des soupapes, afin d’évacuer les tensions.
Ce n’est pas nouveau que le pouvoir économique et politique tende à tout phagocyter et digérer, toujours plus rapidement, comme par exemple dans le cas des perles de néoconservatisme et de conformisme antisexiste, antiraciste etc, qui nous sont élargies jour après jour par les médias.
Je pense qu’un premier malentendu dérive de l’incapacité de situer correctement certains comportements, réduisant à des problèmes de genre ce qui devrait toucher à une critique plus large, anti-autoritaire, des rapports et des capacités de communication et d’interaction entre des individus.
Il faudrait laisser la catégorisation par genre, en mode LGBTI (XYZ…), à ceux qui ont besoin de se sentir partie d’une catégorie protégée, dans des rangements plus semblables à une classification linnéenne des différentes combinaisons entre individus, qu’à des corps et des esprits libres. On se retrouve, par contre, face à des tels rangements dans des milieux anti-autoritaires, qui devraient en avoir déjà intériorisé le refus.
Au passage, je ne crois pas du tout que les prétendus espaces libérés le soient toujours par de vrai ; au contraire, ils deviennent souvent des repaires de différents malaises qui, au lieu d’améliorer la qualité de la vie et des rapports, risquent de les enfoncer encore plus.
Ce n’est pas possible, par exemple, de lire avec la clef interprétative du sexisme, de l’imposition autoritaire ou de la violence de genre toute incapacité à interagir, même lors d’assemblées ; j’ai lu dans une brochure (1) qui a circulé l’année dernière, afin de stigmatiser la violence latente dans les rapports entre compagnons, que « alors le plus vieux exerce le pouvoir sur le plus jeune, celui qui a plus d’expérience s’impose sur celui qui en a moins, le plus fort sur celui qui est moins fort, en récréant ainsi, comme dans un miroir, les relations du monde qu’on dit vouloir subvertir ».
Cette critique voudrait cibler des attitudes autoritaires qui se produisent dans des milieux anti-autoritaires, et elle pourrait avoir du sens, mais banalisée de cette façon elle nivelle tout : il y a une différence essentielle entre imposition de la force et expression de l’expérience… en cas contraire on arrive à cette stupidité qui est l’éloge de l’incapacité et de l’inaction.
Le concept de violence émotive ou de violation de l’intégrité émotionnelle est on ne peut plus flou ; pourquoi favoriser la diffusion de camelote analytique de ce type parmi des individus anti-autoritaires, qui devraient posséder des instruments de critique et des capacités d’intervention concrète bien plus tranchantes ? Cela, en plus, en vidant de sens la brutale violence subie, à laquelle elle est comparée. Comment prétendons-nous nous engager dans un combat sans quartier contre l’autorité et discuter de violence révolutionnaire et libératrice, si on n’arrive même pas à réagir individuellement à un « commentaire non demandé dans la rue » (en le voyant pour ce qu’il est et traitant en conséquence celui qui l’a craché) ou à avoir une discussion acharnée, lors d’une assemblée, sans recourir au prétexte de la sensibilité brisée ? Pourquoi se retrouver à lire la déconcertante et idiote lapalissade qui conseille, pour éviter une IVG non désirée, de faire l’amour avec une femme (2) ? Pourquoi considérer comme une conquête le fait que, par exemple par rapport au genre, l’autodéfense des agressions et des harcèlements soit un « sujet qui concerne seulement des bandes de femmes » ? Ce n’est peut-être pas un problème commun aux genres, entre des êtres libérés ?
Pourquoi ressortir des oubliettes des années 70 les produits les plus frustes, tel les rencontres en non-mixité… même en les appelant work-shop (un mot très moche, qui conjugue travail et magasin, tiré de congrès d’entreprise et non digne de la libre discussion) ?
Je trouve le spectre d’un tel mécanisme réductif et banalisant aussi dans une autre publication récente, l’édition italienne des communiqués de revendication de Rote Zora (3), c’est à dire la volonté de sensibiliser seulement un publique féministe sur un groupe de femmes qui ont pratiqué la lutte armée dans l’Allemagne des années 80 et 90, en insistant sur le choix de genre, très intéressant pour ce qui est de certaines thématiques féministes, comme d’une raison pour ôter l’oubli qui leur est tombé dessus, puisque on ne veut pas « qu’elle rentre dans l’histoire officielle. Elle est écrite par des hommes (4) » Mais… ce ne serait pas que l’histoire officielle tendrait à ne pas parler d’elles parce qu’elles étaient des enragées, pas parce qu’elle étaient des féministes enragées ? Tout comme l’histoire officielle n’affronte pas – ou déforme – l’expérience, les actions, les écrits de nombre d’autres enragées et enragés ? Une vision partielle qui n’est pas celle des Rote Zora, qui ont expérimenté leur parcours de lutte et de libération, individuelle et collective, au sein d’une plus large action anti-impérialiste et anticapitaliste, mais qui appartient à qui essaye de faire d’elles un drapeau pour donner plus de crédibilité et de poids à ses théories, peut-être pour en arriver par la suite à chercher des simples « parcours d’auto-défense ».
Pourquoi se retrancher dans un discours « féministe et lesbien » (5), pourquoi une autre cage protectrice, plutôt que développer la beauté et les infinies suggestions de critiques plus pointues à la domination (pas seulement à la domination de genre) qui ont été expérimentés et qui sont offertes ?
J’ai toujours vu la « sororité » comme une forme d’aliénation qui suggère des alliances politiques transversales entre opprimés et oppresseurs, entre des parties adversaires… des alliances « interclassistes », comme c’est à nouveau à la mode de dire. De ces temps, je suis tombées aussi sur une brochure (6) d’entretiens faits par une féministe italienne à quelques vétéranes de la révolution espagnole de 1936, avec la finalité de chercher une quelque « sororité » entre des femmes anarchistes au front (ou dans les arrières, avec les Mujeres Libres) et des femmes du POUM ou des stalinistes. C’est remarquable que des révolutionnaires anarchistes de presque cent ans soient beaucoup plus lucides et ouvertes, dans la critique aux limites du féminisme, que celle qui les interviewait, imprégnée de lieux communs des années 70 ; avec l’extrême tranquillité d’une vie pleinement vécue, elles arrivaient à expliquer avec simplicité les rapports paritaires entre compagnonnes et compagnons, comment elles arrivaient à tourner en ridicule et à neutraliser les machismes qui émergeaient parmi les plus arriérés et stupides de leurs compagnons. Je veux dire que les pratiques et la contribution théorique de ces femmes sont bien plus avancées dans le parcours de libération de l’individu et de négation des dynamiques d’autorité que celles des féministes qui picorent leurs expériences tout en défendant des simulacres de lutte plutôt que la lutte elle-même.
La nécessité d’autodafés, la « déconstruction de ses privilégies de mâle », la recherche d’espaces de discussion séparés, les pratiques de l’autoconscience et de l’auto-analyse en public me paraissent un peu trop être un signe de ces temps de surexposition et d’approximation, une façon de faire étalage des « luttes » catégorielles et des luttes intérieures pour finir par ne pas lutter du tout.
Anna
MAF de Rebibbia
octobre 2018
Notes :
1. « Violenza di genere in ambienti antiautoritari ed in spazi liberati« , édition italienne traduite depuis l’original espagnol, 2017.
2. « Critica all’aborto« , Jauria, Pubblicazione transfemminista per la liberazione animale, n. 1, estate/autunno 2015.
3. « Rote Zora – guerriglia urbana femminista« , Autoproduzione femminista, 2018.
4. Depuis l’introduction du même livre.
5. Chose que les Rote Zora elles-mêmes ne considéraient pas une caractéristique fondamentale. Dans une interview aux Rote Zora de 1984 : « Certaines parmi nous ont des enfants, beaucoup d’autres non. Certaines sont lesbiennes, d’autres aiment les hommes ». Ibid. p. 51
6. « Donne contro« , Isabella Lorusso, CSA editrice, 2013.